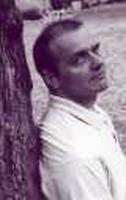Interview de Pierre Bordage recueillie par Bibirox.
Bibirox : Bonjour Pierre Bordage et merci d'avoir accepté cet entretien. Rentrons si tu le veux bien dans le vif du sujet.
Avec L'Ange de l'Abîme, tu signes peut-être ton roman le plus sombre, le plus pessimiste. D'où te vient ce goût pour les histoires sombres ? Peut-on dire que cela suit une logique, dans ta carrière d'écrivain ? Une maturation de ton positionnement dans l'horizon S-F ?
Pierre Bordage : Deux réponses :
1) Les circonstances de l'écriture du roman. Il m'a été inspiré, non pas par le 11 septembre 2001, mais par les réactions au 11 septembre. Au lieu de s'interroger sur les causes du déséquilibre mondial, l'Occident, par ses représentants les plus agressifs légitimés par l'attentat qui plus est, ont désigné un axe du mal, une culture du mal, une religion du mal. Ils ont appelé à une nouvelle croisade au nom de leur Dieu, le dieu des chrétiens, réveillant de vieux réflexes organiques, de vieux démons à peine retournés dans leur tanière. En tant qu'auteur d'anticipation, j'ai pris la liberté de mener la croisade, et j'ai abouti à une guerre terrible entre deux grandes religions monothéistes sur le sol européen. À la destruction, à la souffrance donc. D'où cette vision sombre, pessimiste.
2) C'est le propre des héros que de se mettre en quête pour rétablir l'harmonie ou l'équilibre dans leur monde. Le héros part donc d'un environnement en souffrance, symbolisé dans le Graal par la blessure du roi et le dépérissement du royaume. Ulysse ne s'éloigne pas d'Ithaque pour faire une croisière sur la Méditerranée, mais bel et bien parce qu'il participe à une guerre. On pourrait multiplier les exemples. Je ne fais que m'inscrire dans une longue tradition de conteurs qui se servent des souffrances du monde pour mieux contraindre leurs personnages à se lancer dans l'aventure. Il n'y a pas de logique ou de plan de carrière là-dedans, seulement le contexte d'un roman qui se met en place. Si un roman nécessite un autre contexte, cela ne me posera pas le moindre problème de conscience. De même, je me fiche comme de ma première page de mon positionnement dans l'horizon de la SF, je me consacre aux livres qui me traversent, point.
B : Les héros de tes romans sont souvent confrontés à des situations qui les amènent à évoluer, à se transformer. Est-ce à dire que le malheur constitue le ferment des héros ?
PB : Cette question rejoint la réponse précédente. Encore une fois, seul le déséquilibre ou le vide peuvent mettre les héros en mouvement. Sinon, les bougres, ils ne bougeraient pas le petit doigt ! Pour accepter le changement, la métamorphose, la souffrance, les épreuves, il faut que quelque chose, la nécessité ou les circonstances, vous y pousse. Il me semble d'ailleurs qu'on pourrait étendre cette réflexion à l'humanité toute entière : elle n'avance que sous le coup du déséquilibre ou de la contrainte. Elle cherche alors peut-être à retrouver l'Éden des premiers temps, cette unité primordiale perdue, ce rapport privilégié avec son environnement. Comme vous le dites abruptement, le malheur constitue le ferment de l'héroïsme.
B : Dans L'Evangile du Serpent et L'Ange de l'abîme, tu t'es détaché de la S-F pure. On est plutôt dans le roman d'anticipation. Cela veut-il dire que tu te prédestines à la littérature blanche ?
PB : Un, l'anticipation, que je sache, est une branche de la SF. On ne compte pas les chefs d'oeuvre de SF qui sont des oeuvres d'anticipation : Le meilleur des mondes, 1984, etc. Si j'ai besoin de l'anticipation pour étudier une évolution plausible ou simplement possible de notre présent, je l'utilise sans me poser de question. Je ne me prédestine donc à rien du tout ou je ne connais pas les termes de la prédestinée, ni à la littérature blanche ni à une autre forme de littérature, j'écris les livres qui me traversent, qu'ils se passent dans le présent, dans le passé ou dans le futur.
B : Faire selon une nécessité intérieure plutôt que selon les attentes des lecteurs, c'est un risque, mais c'est aussi la meilleure manière d'éviter d'être enfermé dans une catégorie.
PB : Je n'ai pas la sensation de prendre un risque. Je me vois mal écrire les romans sans être guidé par une nécessité intérieure. L'écriture est un exercice tellement exigeant, tellement déstabilisant, que je ne tiendrais pas le coup si je n'avais pas le secret espoir de changer le monde (en toute simplicité). De même je ne cherche pas à être enfermé dans une catégorie ou à me libérer d'une catégorie. Le jeu commercial veut que les livres soient classés dans telle ou telle catégorie, mais à l'intérieur, je ne sens ni cloison ni limite. L'écriture est un domaine de liberté absolue, intime, pourquoi chercher à la mettre en prison ?
B : Une fois de plus la religion a une place centrale dans l'histoire. Mais l'on repère un antagonisme entre d'un côté les pouvoirs religieux instaurés et l'individu isolé, qui lui détient une véritable conscience spirituelle. Peux-tu nous en dire plus ?
PB : Un système religieux quel qu'il soit est pour moi une construction objectivée, un objet, et donc implique une séparation, exactement le contraire de l'étymologie du mot religion, relier. Le pouvoir religieux n'est qu'un pouvoir comme les autres dans le champ de la matière et dont le propos est de contrôler l'être humain, le maintenir dans un système de croyances et de dogmes, justifier donc par tous les moyens sa propre existence. Le véritable élan spirituel, lui, se base uniquement sur l'expérience directe et vise à sortir l'être humain de la prison de l'espace temps, le ramener à sa véritable nature, qui est pour moi celle du créateur. Une petite citation de Silesius, mystique chrétien du XVIIIème siècle, vaudra mieux qu'un long discours : « Homme, si tu libères ton esprit de l'espace et du temps, tu peux à chaque instant être dans l'éternel ». Ou encore : « Tu n'es pas dans l'espace, c'est l'espace qui est en toi ». Quelle religion emmène ses adeptes dans l'espace intérieur ? Il faudrait pour cela quelle accepte de s'effacer, de disparaître.
B : Si l'on devait caractériser en deux mots ton inspiration philosophique, on nommerait la philosophie orientale d'un côté, et l'humanisme de l'autre. Pourtant, ces deux traditions ont des origines radicalement différentes. Jusqu'à quel point peut-on les concilier selon toi ?
PB : Ah que oui ! Si on s'intéresse à l'humanité, à la matière humaine, on ne peut que chercher à lui éviter cette souffrance qui semble son lot perpétuel. Comment faire ? On peut essayer dans la champ de la matière, le champ objectif, le combat, la lutte, comme l'ont tenté les révolutionnaires français ou les communistes, mais on constate que la souffrance est toujours là, que l'histoire, qu'on essaie de nous vendre comme un devoir de mémoire, n'apporte aucune amélioration, que les mécanismes anciens se mettent toujours en mouvement. On se tourne alors vers les philosophies, orientales ou autres, vers les très anciennes traditions, on y cherche des réponses, on les applique avec sincérité. On peut aussi les concilier toutes deux : agir dans le champ de la matière et dans celui de l'esprit. Mais je crois de plus en plus que l'esprit est l'essentiel, que l'espace est intérieur, subjectif, que, sans la vision pénétrante dont parle Krishnamurti, les différentes démarches pour sortir l'humanité de ses ornières sont vouées à l'échec, à l'éternel recommencement.
B : Vaï Kai est un héritier de la tradition shamanique. Mais c'est aussi le représentant du Christ. Cela fait de lui un étranger (le récit se déroule en Europe), mais aussi celui que tout le monde attend, le Sauveur. C'est donc un personnage ambivalent. Qu'est-ce que cela apporte selon toi au roman ?
PB : D'abord le fait que Vaï Kai ne soit pas de tradition occidentale oblige ses interlocuteurs à bousculer leurs schémas de pensées, donc de créer une ouverture. Ensuite il n'est pas le représentant du Christ, il est le Christ, comme, je le pense, chacun d'entre nous. C'est à dire qu'il a la capacité, en tant qu'homme, d'atteindre l'état divin, la fusion avec le Père. Il ne se présente pas en tant que sauveur, de celui qui rachète tous les péchés de l'humanité, mais en tant que grand frère, celui qui ouvre la voie. Les peuples premiers, souvent méprisés, souvent spoliés, parfois détruits, ont beaucoup de choses à nous apprendre sur le plan de l'expérience, de la perception directe, de la subjectivité. C'est sans doute le principal apport de Vaï Kai au roman, cette invitation lancée aux hommes de replonger dans leur Soi, de jeter au feu ces substituts médiocres, et parfois terrifiants, que sont les croyances, les dogmes.
B : Des évangélistes, des archanges, est-ce que le jeu de rôle In Nomine Satanis et Magnas Veritas t'a influencé dans ton écriture ?
PB : Pas du tout. J'ai joué une fois au jeu de Vampire, lors dune convention de jeux de rôles à Orléans. Ça ne ma pas déplu, mais, avec les romans, je joue déjà en permanence avec des personnages.
B : L'Evangile du Serpent sera-t-il adapté au cinéma ? Est-ce que tu t'occuperas de la novélisation ?
PB : L'adaptation est en bonne voie. En aucun cas je ne ferai la novélisation, car le roman est déjà écrit, mais, si le film se monte, je participerai peut-être à la mouture finale du scénario.
B : Pour quand est prévu le dernier volet de la trilogie ?
PB : Sans doute dans le courant de l'année 2005. Il s'agira cette fois d'explorer le coeur de l'homme.