L'hôtel du dauphin est un hôtel comme il y en a beaucoup. Le genre d'hôtel dans lequel personne ne voudrait s'arrêter, un hôtel miteux, tenu par un patron à l'air de parfait looser qu'on imagine avec une calvitie naissante. Une seule servante s'occupe de l'accueil, du ménage et des repas. C'est une vieille fille obèse, une sorte de femme-éléphant. Peinture défraîchie, mobilier des années cinquante, couloirs déserts, peut-être même des zones d'humidité. Et puis, l'hôtel du dauphin est un peu bancal. Littéralement, il fuit le regard. Ça doit être un hôtel un peu lâche. Pour le regarder en face, il faut incliner la tête. « Si l'on s'y habitue, on ne pourra plus s'empêcher de tout regarder, même le monde normal, en inclinant légèrement la tête ». Si vous vous arrêtiez dans ce genre d'hôtel par une nuit d'averse par exemple, ou à la suite d'une crevaison, nul doute que son image resterait enfouie au plus profond de votre mémoire. Quand le personnage principal de Danse, Danse, Danse décide d'y revenir, on sait déjà qu'il retrouvera aussi un lieu à la logique obscure, vivier de hasards objectifs et de rencontres aux accents surréels.
Suite de La Course au mouton sauvage, Danse, Danse, Danse est servi par cette incantatoire typiquement murakamienne qui fait tout le charme des romans de l'auteur japonais. Le narrateur, à la recherche des zones oubliées de son moi profond, instaure une cabale improbable faite de petites habitudes. Au fil de ses allées et venues dans un hôtel désert, de ses séances de cinéma quotidiennes où il visionne à chaque fois le même film, et dans la rythmique des rencontres où surgissent les figures de la jeune adolescente mystérieuse, de l'homme-mouton et de l'ami d'enfance (trois personnages que Murakami utilise de manière récurrente dans ses romans), l'étrangeté se prépare à jaillir. Sur fond d'un décorum banal qui n'en finit pas de remuer vers un symbolisme indéchiffrable, le récit, toujours à la limite du fantastique, mêle tranche d'absurdités urbaines et bureaucratiques, doux tempo rockn roll, et érotisme subtil.
Ainsi du passage de l'interrogatoire, passage ambigu, lourd d'une ambiance et d'un non-sens que Kafka ne renierait pas. Réparties improbables de policiers qui cherchent eux-mêmes à se persuader de la valeur de leur métier, dans une machine administrative folle, silences d'un narrateur qui n'en finit pas de s'étonner de la tournure inquiétante de l'interrogatoire dément, durée de l'entretien lui-même, qui semble ne jamais vouloir se terminer, autant d'éléments qui contribuent à faire de cette scène un épisode irréel et oppressant. Ici, réalité brute et surréalité quasi-onirique, poussées l'une et l'autre à leur paroxysme, finissent par se superposer et à dissoudre leur opposition.
Particulièrement bien amené, le dénouement du récit est cadencé selon une logique qui rend fort à propos le titre du roman. Tout en retenue et en tact, une histoire simple et obsédante tout à la fois, un autre reflet de l'écrivain lui-même, une autre répétition du récit auto-fictionnel sans fin que Murakami nous conte depuis ses débuts. De la grande littérature sans prétention, pour redécouvrir l'imaginaire du quotidien.
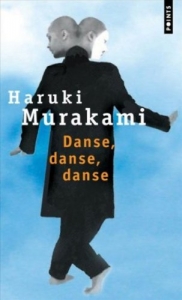
Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.