Me Guido Guerrieri se demande pourquoi Fabio Paolicelli l'a nommé comme avocat. Or, il reconnait immédiatement en lui Fabio Ray-Ban, qui faisait partie de la bande de petits délinquants fascistes qui l'a battu alors qu'il était enfant. De plus, il trouve absurde que cet homme persiste à dire que les quarante kilos de cocaïne que l'on a trouvés sur sa voiture n'étaient pas à lui. Tout cela pour dire qu'il n'a pas vraiment envie de se charger de cette affaire.
Mais le Paolicelli en question a une femme belle et émouvante, et une petite fille de six ans plus belle encore, et à qui l'absence de son père donne des cauchemars... Et puis, pourquoi s'entêter dans ces affirmations stupides si elles n'expriment pas la vérité ? En somme, Guerrieri a des raisons de douter. Il sait toutefois qu'il lui sera difficile de les faire partager aux juges de la cour d'appel.
Que ce soit clair tout de suite : ce roman n'est pas un polar au sens strict du terme, à savoir un/des policier/s + un crime + une enquête + un coupable + une arrestation, dans le meilleur des cas. Guido Guerrieri a moins à voir avec son compatriote, le commissaire Montalbano créé par Andrea Camilleri, qu'avec Perry Mason : son travail consiste à défendre des gens accusés de délits divers. La plupart du temps à juste titre, il faut bien l'admettre, et c'est sans doute là sa différence avec le Perry Mason justicier au coeur pur de nos enfances. Guerrieri vit dans un monde en demi-teintes, et lui-même n'est pas tout beau tout propre. L'aspect le plus touchant du personnage est, selon moi, l'insistance même qu'il porte sur ses propres faiblesses et défauts, prompt qu'il est à s'accuser, à se traiter de crétin ou de salopard, voire à prendre sur lui les faiblesses des autres.
Son personnage central est donc sans doute le principal intérêt de ces Raisons du doute, comme d'ailleurs des autres histoires qui l'ont comme protagoniste. Outre la personnalité de cet avocat, qui semble devoir énormément à son auteur (cultivé, intelligent, désabusé sans être cynique, et homme de gauche, en plus d'être juriste, bien sûr !), j'aime personnellement beaucoup la façon dont il l'écrit, alternant dialogues intérieurs et "extérieurs". Le personnage, récurrent lui aussi, de Carmelo Tancredi, le policier ami qui permet à l'avocat d'avoir accès aux facilités policières, est une autre réussite, comme la belle Natsu Kawabata, ou le libraire insomniaque. Par ailleurs, l'usage du passé simple s'est maintenu en italien, surtout dans le Sud de la péninsule, et bien sûr surtout à l'écrit. Comme je regrette personnellement beaucoup sa quasi-disparition de l'écriture française, je me réjouis de le voir faire retour grâce à une traduction respectueuse du rythme de l'original, et qui nous rappelle du même coup son irremplaçabilité quand il s'agit de rendre compte d'une action ponctuelle située dans le passé.
Indépendamment de la qualité des personnages et de l'écriture, l'histoire, où plane sans cesse l'ombre omniprésente et quasi-omnipotente de la 'ndrangheta, n'est pas sans intérêt. Ce qui m'y a le plus retenue, toutefois, c'est le thème de la mémoire, d'une part, et de la capacité à changer d'autre part, les deux étant reliées : dans ce roman, c'est l'interrogation centrale. Guerrieri se demande sans cesse si vraiment Paolicelli a changé, s'il a cessé d'être la petite brute fasciste dont il a gardé le souvenir. Comme il se demande aussi à quel moment lui-même a cessé d'être ce jeune avocat heureux d'arriver au tribunal le matin de bonne heure, cet idéaliste, convaincu que coucher avec l'épouse d'un client est une honte absolue. Et ce Paolicelli peut-être assassin, ou pour le moins complice d'assassins, et ce Guerrieri sans peur et sans reproche, ont-ils vraiment existé ?
Gianrico Carofiglio est aussi célèbre en Italie que Fred Vargas en France. Il serait temps que nous lui accordions la même reconnaissance que les italiens accordent à Vargas, car vraiment ses romans sont de petits bijoux et de vrais plaisirs de lecture. Aucune raison d'en douter une fois qu'on a dégusté celui-ci !
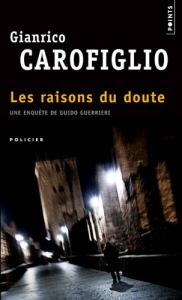
Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.