Le livre est sous-titré : Histoire d'un asile et de ses pensionnaires, de Nerval à Maupassant, et cela résume bien le contenu, même si l'histoire de la clinique commence avant Nerval, précisément en 1821, quand le Dr Esprit Blanche acquiert un bâtiment à Montmartre pour y créer une maison de santé privée destinée à héberger les aliénés. En fait, d'ailleurs, dans le détail, il y aura deux maisons - l'une à Montmartre, l'autre, succédant à la première devenue trop petite et malcommode, à Passy - et deux docteurs Blanche, le père et le fils.
Au début du XIXe, si les fous, depuis une date fort récente, ne sont plus enchaînés, la société et les familles ne savent pas qu'en faire, et la psychiatrie est en cours de création. A la fin du siècle, si l'arsenal thérapeutique n'a pas encore pris l'ampleur qu'on lui connaît aujourd'hui, le psychiatre est partout, notamment au tribunal, et les questions de l'origine de la maladie mentale, des liens entre folie et crimes, et folie et révolte sont toutes posées. Les réponses qui leur sont données différeront d'une période à l'autre, d'une société à l'autre, d'un régime politique à l'autre. De toute cette évolution, la "maison du Dr Blanche" a été un témoin privilégié.
Bourgeois aisé et cultivé, Emile Blanche a aussi été un témoin de l'art de son temps, qu'il s'agisse de littérature, de musique ou de peinture, et il a eu comme patients un bon nombre d'artistes, dont bien sûr Nerval, dont la particularité est d'avoir été soigné par le père et le fils Blanche, et Maupassant, mais aussi Charles Gounod, par exemple.
L'auteure a eu accès aux dossiers de la maison de santé avant leur malencontreuse disparition. Elle s'est aussi appuyée sur le livre de souvenirs du fils d'Emile Blanche, et sur une abondante correspondance. Le corpus de notes en fin d'ouvrage témoigne de ces références. Le style est très vivant, et ce document important se lit avec plaisir. Je ne dirais pas pour autant qu'il est facile à lire, ce qui est normal vu son sujet. Mais pour ceux qui s'intéressent à l'évolution de la vision française des rapports entre santé mentale et maladie mentale, c'est absolument passionnant.
Laure Murat montre bien, par exemple, comment, au milieu du XIXe siècle, une femme qui manifestait le désir de gérer elle-même sa vie, et notamment sa fortune, était considérée comme folle par sa propre famille, et enfermée en tant que telle, avec l'aval de bonne foi des psychiatres, qui justifiaient cette décision en décrivant une pathologie ad hoc. En fait, étudier l'histoire de la psychiatrie, c'est étudier l'histoire de ce que les sociétés successives ont considéré comme la normalité. L'auteure s'appuie sur l'exemple des femmes, mais on peut aussi songer à l'homosexualité.
La façon dont la maison est gérée est aussi fascinante : il s'agit de ramener les malades à la raison, de façon très normative, selon un système récompense/punition, en les "ré-éduquant" en quelque sorte, en les faisant vivre dans une espèce de famille idéale, avec le Dr Blanche et son épouse dans le rôle du père et de la mère. Cela pour ceux qui en sont capables, bien sûr. Pour les autres, il y a les douches et bains, la purgation, la nutrition par sonde, et bien sûr l'enfermement, accompagné ou non de contention.
En somme, une lecture qui fait froid dans le dos par moment, mais qui est captivante, et que je ne peux que recommander vivement à tous ceux que le sujet intéresse. Le livre a obtenu le Prix Goncourt de la biographie et le Prix de la critique de l'Académie française, en 2001. Depuis, l'auteure l'a revu, notamment à la lumière de publications récentes, et c'est cette édition revue qui est publiée ici.
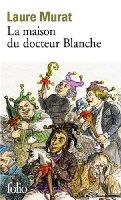
Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.