Il y a cinquante ans, l’humanité a rencontré pour la première fois une espèce extraterrestre, une forme de vie insectoïde qui lui a valu le surnom de « Doryphore ». Mais cette rencontre est loin d’avoir été amicale et il a fallu tout le génie stratégique de Mazer Rackham pour venir à bout de ce qu’il convient d’appeler une invasion sanglante. Cette victoire des hommes a permis de découvrir une avancée technologique majeure : l’ansible, permettant de communiquer instantanément d’un bout à l’autre de la galaxie.
Sur Terre, l’humanité est congestionnée de population. Les blocs Américain et Russe, ennemis héréditaires dont les tensions politiques peuvent mettre en péril toute la planète, sont provisoirement en trêve contre l’ennemi à venir que sont encore les Doryphores. Car si la victoire de Rackham a mis en déroute l’invasion, les extraterrestres sont encore présents dans plus de 80 systèmes de la galaxie.
Une stratégie de la dernière chance est mise en place dans l’espoir de contrer une nouvelle invasion Doryphore. Une école de guerre forme les futurs officiers, rigoureusement sélectionnés, à devenir le nouveau général capable d’égaler Rackham. La famille Wiggins donne naissance à des enfants exceptionnellement doués. Mais Peter est trop violent et Valentine trop douce : ils sont écartés avant d’intégrer l’école de guerre. On demande alors aux parents Wiggins d’enfanter un troisième enfant, malgré la loi des de restriction de la population, dans l’espoir que le cadet mêle les qualités de ses deux ainés. Andrew Wiggins, surnommé Ender par sa sœur, « celui par qui tout finit », est une recrue prometteuse.
Ce résumé vous semble long ? Et pourtant, il ne résume que les trente premières pages du roman. C’est vous dire si l’univers d’Orson Scott Card est riche, construit, intelligent. Et pourtant il ne se perd pas en circonvolutions narratives. Il va à l’essentiel, trace avec efficacité ses personnages, son univers et son histoire.
Il faut dire que la structure du roman est particulièrement efficace : en début de chaque chapitre, un dialogue entre deux mystérieux individus dont on ne comprend les propos que lorsque l’histoire avance, quitte à revenir lire ces passages à rebours. Puis le chapitre centré sur Andrew « Ender » Wiggins, jeune prodige confronté à des épreuves censées le forger comme on forge une lame en acier trempé. D’abord chez lui, monitoré par les généraux pour vérifier ses aptitudes, puis à l’école militaire, puis… Et parfois, un chapitre centré sur la sœur d’Ender, Valentine. Une sœur qu’il adore autant qu’il déteste ce frère cruel et violent qui lui fait peur. La structure du roman, parfois déroutante, demande à son lecteur la même souplesse d’esprit qu’à son héros, la même capacité d’adaptation. Les épreuves du lecteur sont de dénouer les fils narratifs, de comprendre où l’auteur veut arriver. Joueur, Orson Scott Card nous laisse deviner le superflu qu’on pense être l’essentiel et l’essentiel est une révélation.
On regrette seulement une ambivalence Amérique / Russie très datée. Mais pour un roman écrit en 1985, on en comprend toutefois la raison. Pourtant, au sein de cette guerre froide fantasmée dans un futur qui s’écrit dans les étoiles, les tensions politiques mondiales et le système d’influence des penseurs politiques donnent un écho moderne très surprenant. Ces penseurs qui communiquent uniquement par média au sein de la planète, ces blogueurs / influenceurs d’avant-garde capables de jeter le feu au poudre ou de susciter l’idolâtrie sont de plain-pied dans notre actualité. Tout aussi avant-gardiste, l’importance des simulations, des jeux vidéo et de la technologie sur l’éducation et la construction de soi chez des enfants aseptisés, à mi-chemin entre l’adulte névrosé et le robot tout en logique. Point de sentiment à l’école de la guerre. De la stratégie et de la discipline.
Et c’est bien là la force du roman : cérébral tout en étant accessible, daté mais prophétique, critique mais pas bien-pensant, et un héros, futur général de la flotte galactique, qui sort tout droit d’une épopée d’Homère. Bravo.
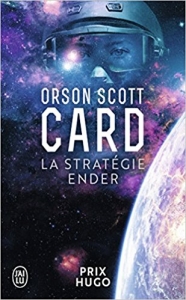
Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.