Les notes qui m'ont permis de rédiger cette chronique ont été prises lors d'une table ronde portant ce titre, qui s'est déroulée dans le cadre des Utopiales 2018. Les participants en étaient Sylvie Bérard, Yves Meynard, Jean-Louis Trudel et Elisabeth Vonarburg.
Les participants à cette table ronde, et notamment Elisabeth Vonarburg qui était présente dès les débuts de l'aventure, ont développé pour le public européen présent dans la salle les raisons pour lesquelles le fanzine Requiem était devenu la revue Solaris : c'était lié au désir de professionnalisation, avec la volonté de payer les auteurs qui y publiaient et, pour ce faire, d'obtenir des subventions. Quant au nom, il a été choisi par Norbert Spehner, en référence au roman éponyme de Stanislas Lem, dont il était fan.
Au fil du temps, la revue est devenu un outil important pour la création de la communauté des auteurs canadiens francophones. Elle s'est transformée peu à peu, et chaque directeur littéraire y a laissé sa marque personnelle, même si tous les participants sont multi-tâches et multi-talents. Le projet était et reste de garder un équilibre entre permettre l'accès aux pages de la revue à de nouvelles plumes, et maintenir son degré d'exigence et de niveau de qualité. D'ailleurs, l'un des points positifs de la revue est cette même exigence, qui pousse les auteurs à mieux faire, et qui est assurée par une véritable direction littéraire autour des textes proposés. Le lien de la revue avec les éditions Alire date de 2000, sans que ce changement ait entraîné de modification dans le fonctionnement de Solaris.
Passée la période des tout débuts, d'abord de Requiem puis de Solaris, dont Norbert Spehner a été directeur littéraire pendant dix ans, le poste a vu plusieurs personnes s'y succéder, dont Yves Meynard pendant quelques années, mais celui qui a occupé le poste pendant le plus longtemps - vingt ans - et qui a marqué la revue a été Joël Champetier, disparu en 2015. Elisabeth Vonarburg souligne à cette occasion que la direction littéraire de la revue est collégiale, assurée par une équipe.
En ce qui concerne le petit nombre d'auteurs européens présents dans ses pages, Jean-Louis Trudel rappelle que Solaris bénéficie de subventions du gouvernement canadien, du gouvernement québécois, et d'une maison d'édition basée au Québec, ce qui explique la priorité donnée aux auteurs "locaux". Par ailleurs, il rappelle d'une part que lors de ses débuts, et jusque dans les années 1990, les pages de la revue étaient tout à fait ouvertes à des auteurs venant de partout, avant une période de fermeture de quelques années, et d'autre part la création du prix Joël Champetier qui vise à récompenser un texte écrit par un auteur francophone non canadien.
Sylvie Bérard, après avoir fait part de la façon dont sa participation en tant qu'auteure à la revue lui a permis d'écrire son premier roman, souligne l'intérêt de la rubrique Critiques de la revue, qui lui permet de se tenir au courant des parutions dans le genre des littératures de l'Imaginaire, à peu près absentes des pages des revues et journaux "généralistes".
Pour les raisons que pourraient avoir des lecteurs européens de lire la revue, il y a le fait que les textes de fiction qui y figurent sont pour les trois quarts francophones, et à 100% signés par des auteurs contemporains, l'intérêt des articles de non-fiction qui y sont inclus, et la curiosité pour les auteurs francophones canadiens dont il serait difficile de trouver les textes ailleurs.
L'affiche originale des Utopiales est signée Beb-Deum.
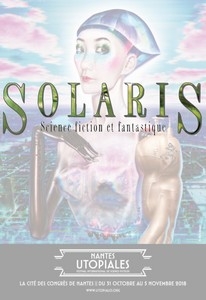
Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.