Cette chronique reprend les notes que j'ai prises lors des Utopiales 2018, et plus spécifiquement durant les conférences suivantes :
C'est une donnée de base que notre corps physique est quelque chose que nous n'avons pas choisi, mais que nous avons à subir. Les participants à ces différents cours et tables rondes ont disserté sur les différentes façons dont, au fil du temps, les humains ont cherché à acquérir quelque maîtrise sur ce corps qui nous échappe, nous plongeant dans une incertitude angoissante. Chacun y répond à sa façon, par la cosmétique ou cette prise de possession du corps que constituent les conduites déviantes par rapport à la nourriture, les blessures auto-infligées... ou les selfies, qui visent à produire une image de quelque façon contrôlable, et validée par les autres.
Les religions ont très tôt visé à prendre le contrôle de la naissance et de la mort, et c'est un projet qui reste inscrit en Occident, même si les religions y ont perdu une grande part de leur influence. Qu'il s'agisse de choisir l'instant de sa mort, ce qui peut se faire en Belgique ou en Suisse, si c'est interdit en France, ou de repousser la putréfaction de la chair, il s'agit du projet de rester soi aussi longtemps que possible, voire éternellement. Or, comme l'éternité ne nous est en fait accessible qu'au travers des éléments qui nous constituent, il n'est pas étonnant que l'église d'Orient considère le corps non putréfié comme malfaisant. On reconnaîtra son équivalent littéraire dans la figure du vampire.
Une autre figure qui apparaît dans le cadre des tentatives de maîtrise du corps, c'est celle du médecin. Le médecin fou est une variété du savant fou, qui apparaît dans la littérature, au cinéma et dans les comics, comme dans la vie réelle. C'est celui qui pense que l'intelligence peut tout régler, et dont la volonté de puissance et de contrôle s'ancre souvent dans les défauts de son propre corps. Une variété particulière du personnage est celui qui se prend pour Dieu, soit en créant une créature, comme Frankenstein, soit en expérimentant sur son propre corps, comme le Dr Jekyll.
Il n'est pas étonnant que la figure du médecin soit ambivalente dans la culture populaire, qui reflète les craintes et attentes fantasmatiques de la population, étant donné le pouvoir dont il est investi de toucher au corps, et donc à l'intime de chacun, pour le pire mais aussi pour le meilleur. Il est actuellement aidé en cela par les recherches sur la robotique, et la façon dont les prothèses et autres exosquelettes ont récemment progressé. Toutefois, même ces progrès sont de piètres remplacements : subi ou non, notre corps est toujours, et de loin, plus efficace que ces béquilles, quelque nécessaires qu'elles puissent être quand le corps a subi des dommages.
Et qu'y a-t-il de plus endommagé que le monstre ? Dans la vie comme dans l'art, le monstre est la "mise en corps" des choses qui ne sont pas comme nous. Le nom même qui le désigne signifie à la fois "ce que l'on montre" et "présage" : c'est donc celui que l'on pointe, mais dont on attend un éclairage différent sur nous. Il y a des monstres partout dans la religion et dans la fiction : une partie de la SF vise à définir ce qu'est le monstre, ce qui n'est pas nous. Par exemple, la figure du zombie a changé parce que nous cherchons un sens à ce qui peut arriver après une apocalypse. Il sera intéressant de voir comment il continuera d'évoluer. Dans sa dimension politique, le monstre est considéré comme tout ce qui est excessif, y compris dans la normalité, comme le met en scène le roman de Bentley Little, L'ignoré.
L'affiche originale des Utopiales est signée Beb-Deum.
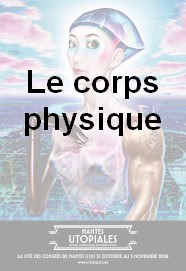
Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.