Cette interview, qui a eu lieu pendant les Utopiales 2019, a été organisée par le service presse de l'évènement.
Mureliane : Jean-Laurent Del Socorro, bonjour, merci d'avoir accepté cette interview pour Les Chroniques de l'Imaginaire. Nous allons commencer par parler de Je suis fille de rage, qui est LA grande actualité du moment.
Jean-Laurent Del Socorro : Bien sûr, avec plaisir.
M : Il y avait vraiment des femmes dans les deux armées, ou ça vous l'avez inventé ?
JLDS : Alors, on est vraiment sur une volonté, d'abord d'écriture, de rééquilibrer cette parité dans les textes, même si effectivement je fais un peu une entorse à la réalité, parce qu'effectivement il n'y a pas eu autant de femmes que ça. Il y en a eu, qui se sont battues. Plutôt dans le Sud. Paradoxalement plutôt dans le Sud ; ça restait très minoritaire, mais il y a eu des femmes qui ont pris les armes. Il y a eu ce que moi j'appelle - pas mal dans le Nord, surtout - des « Mulans », c'est-à-dire des femmes qui se sont grimées en hommes pour prendre les armes. Il y en a eu, avec deux cas de figures : la première, c'était des femmes qui ne voulaient pas être séparées de leur mari, qui était officier. Elles se sont grimées pour pouvoir passer le conflit à côté de leur mari, comme assistante militaire. D'autres voulaient prendre les armes et n'admettaient pas que le Nord ne le leur autorise pas. Elles se sont grimées en hommes pour le faire. Mais dans la réalité il n'y en a pas autant que je le laisse transparaître dans mon récit. D'ailleurs, à ce propos, il y a Bertrand Campeis qui a fait la relecture historique de ça et qui connaît bien mon écriture, qui m'a dit effectivement : "Je ne te le corrige pas. Il n'y a pas eu autant de femmes sur le terrain, mais je sais que c'est ton parti pris d'écriture qu'il y ait cette parité homme/femme dans tous tes romans". Voilà, c'est ce que je défends aussi.
M : Et le camp d'affranchis de l'île Roanoke, c'est un fait historique aussi, ça ?
JLDS : Complètement ! Le camp de Roanoke, c'est l'équivalent de la république de Marseille dans Royaume de vent et de colères. Dans Royaume de vent et de colères, quand je dis qu'il y avait eu une république catholique pendant quelques années, tout le monde croit que c'est une fiction, ça a existé. L'île de Roanoke, qui est l'île qui a servi à abriter des affranchis qui arrivaient des colonies du Sud, des terres du Sud, a réellement existé. Il y avait vraiment une volonté de monter une ville, de faire que les affranchis s'en emparent, qu'ils deviennent autonomes. À la fin de la guerre, il a été décidé de casser cette utopie et de ne pas le faire. Il y aurait d'ailleurs une très belle uchronie à faire, puisque si la ville se crée – et pour la petite histoire, il y avait aussi Shermann qui avait pris des terrains pour que les affranchis créent leur ville sur la côte est des États-Unis, mais finalement ça n'a pas eu lieu – il y aurait pu avoir toute une identité d'affranchis qui créent eux-mêmes leur propre bout de territoire dans les États-Unis. Ça s'est joué à peu. Ça a vraiment été une décision politique, de l'arrêter. Je pense que ça aurait changé beaucoup de choses. Donc, il y a réellement eu, à Roanoke, pendant quasiment toute la durée de la guerre, une utopie. On a dit "on va construire une ville, elle sera donnée aux affranchis à la fin de la guerre". C'est une belle histoire, non ?
M : Ah mais absolument ! C'est pour ça que je me demandais vraiment si ça avait vraiment existé.
JLDS : Et le révérend Horace James, que je fais apparaître, a vraiment été le superintendant de l'île, il y a vraiment eu des écoles. Pour la petite histoire, si vous vous intéressez à ça, il y a eu un très beau livre : The Roanoke Island Freedmen's Colony, par une historienne, Patricia C. Click, qui a été fait sur ça, qui recense l'intégralité des gens qui étaient sur l'île. C'est hyper-touchant. Oui, à un moment, il aurait pu y avoir complètement cette utopie affranchie qui voie le jour.
M : C'est fascinant.
JLDS : Ça, c'est typiquement l'Histoire qui dépasse la fiction.
M : Absolument. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'interview filmée que vous avez faite aux Aventuriales, et je voudrais revenir - et ce n'est pas très loin de Je suis fille de rage - sur le thème de l'insurrection. Pourquoi l'insurrection ? Est-ce qu'on voit mieux un cadre dans ses zones de fracture ?
JLDS : C'est une très belle question, qui m'est posée, et je suis incapable de l'expliquer moi-même. Je pense que, même inconsciemment, si je choisis, dans Royaume de vent et de colères, la question des guerres de religion, qui est quand même aussi le thème central, Boudicca, le thème de l'insurrection d'un pays conquis qui essaie de retrouver sa liberté, ou Je suis fille de rage autour de la question de l'identité d'un pays et la guerre civile, c'est tout simplement que ça me permet de traiter des thématiques fortes, qui sont au nœud, qui sont le point commun de toute insurrection. Parce que, qu'est-ce qu'on a ? On a la notion de liberté, de liberté individuelle, de liberté d'un pays, d'identité d'un pays, il y a plein de choses qui sont communes à ça, qui revendiquent... Parce que finalement la Guerre de Sécession américaine, c'est devenu une guerre de liberté aussi, pour libérer les esclaves, en fait. À un moment, ça a dépassé l'histoire de l'insurrection civile. C'était un propos politique, c'est devenu autre chose. Je pense que le phénomène de l'insurrection est souvent un marqueur qui indique que quelque chose est significatif à un moment T dans une société, dans un pays. Qui plus est, je pense qu'il y a aussi une certaine fascination de se dire : il y a la question d'une société dysfonctionnelle qui nous renvoie à nos problèmes très contemporains, en fait. On est peut-être, sous un format différent aujourd'hui, sous une forme d'insurrection, par exemple en France, avec des mouvements sociaux, des choses comme ça. C'est la réflexion qu'on pourrait avoir avec la Commune de Paris, aussi, dans notre exemple plus franco-français, plus que la Révolution française. Ça questionne globalement l'identité, l'indépendance…
M : Et l'exemple que vous venez de donner de la Commune de Paris me confirme que ce qui vous intéresse, c'est les insurrections qui échouent !
JLDS : Alors, je vais faire un propos de sémantique : c'est que, normalement, un soulèvement populaire qui marche est une révolution. L'insurrection, dans la première définition, est une révolution non aboutie. Donc s'il y a le mot insurrection on sait que ça n'aboutit pas. Voilà. Donc de fait, si je traite les insurrections, on sait qu'elles n'iront pas jusqu'au bout. Ce n'était pas voulu au départ, mais avec ce triptyque - Royaume de vent et de colères, Je suis fille de rage, Boudicca - qui n'en est pas un, on a des thématiques communes. Je pense que j'ouvrirai à d'autres thématiques sur mes prochains textes. Alors, après ce n'est pas gagné parce que je vais écrire prochainement sur la fin de ce qui est non pas une insurrection mais une guerre, la fin de la Reconquista espagnole. On sera à nouveau sur des thématiques d'identité, de conflit religieux, de conflit de civilisations, de vies, voilà. Je pense que ces questions me travaillent. Moi-même, j'ai une mère italienne, je suis d'origine espagnole - je dis souvent que je suis un Méditerranéen. Je pense que cette question de ces nations qui sont brassées, qui se sont opposées, finalement c'est revenir à un terreau, il y a cette question d'identité : d'où on vient, on vit tous ensemble au même endroit, en fait, ça m'interroge. La Guerre de Sécession, pour moi, c'est tout ça... Terrible, en fait... On parle d'un pays qui s'est entre-tué !
M : Oui, c'est comme la Guerre d'Espagne.
JLDS : C'est comme la Guerre d'Espagne, voilà, l'exemple est très très bon : la guerre d'Espagne, pour moi c'est terrible ! On est vraiment sur quelque chose de fratricide : on parle de familles qui se battent entre-elles.
M : C'est ça. Et puis on parle d'un million de morts, ou six cent mille dans le cas de la guerre américaine, mais c'est énorme. Et donc, dans les prochains projets, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui allaient sortir, et qui étaient plutôt à quatre mains. Qu'est-ce que ça vous apporte, l'écriture à quatre mains ? Pourquoi ?
JLDS : Ça m'apporte la possibilité d'avoir des collaborations. Je vais donc effectivement sortir une novella illustrée dans l'univers de Royaume de vent et de colères, La guerre des trois rois, illustrée par Marc Simonetti. C'est aussi et surtout parce que j'avais rencontré Marc Simonetti en table ronde il y a deux ans et demi maintenant. On a immédiatement sympathisé. On s'est vite dit "il faut qu'on fasse quelque chose ensemble". Donc c'est d'abord une rencontre, voilà, j'avais envie de travailler avec lui. Je lui ai proposé ça, il est d'accord, à tel point qu'on joue une espèce de jeu de ping pong, c'est-à-dire que j'ai écrit de façon très visuelle la nouvelle – ce qui ne me ressemble pas du tout – pour lui permettre de s'en emparer. Puis il m'envoie - aujourd'hui il m'a renvoyé des images – et je retouche le texte. Parfois, l'écrit influence le visuel mais je lui ai laissé la balle : le visuel a le droit d'influencer le texte lui aussi. Il y a une espèce de ping pong. C'est précieux. Et l'autre collaboration que vous devez citer, je pense que c'est celle d'Aventures en Savoie, avec Nadia Coste...
M : C'est ça ! Les chevaliers de la raclette.
JLDS : Les chevaliers de la raclette. Je voulais m'essayer à la jeunesse et j'en ai eu l'opportunité, grâce à ce petit roman. Nadia Coste a accepté de faire un tome également. Comme elle était très habituée de la jeunesse, on a travaillé, moi plutôt le tome 1, elle plutôt le tome 2, mais on s'est co-dirigés, on a co-travaillé sur la structuration, sur le plan – alors que je travaille d’habitude sans plan ! Ça m'a permis d’aborder une autre méthode de travail, un autre type de public, une autre approche d'écriture... En fait, comme pour La Guerre des trois rois, c'est aussi un échange. En fait, je pense que l'écriture à quatre mains, pour beaucoup d'auteurs, c'est d'abord la possibilité d'une rencontre avec un autre auteur ou une autre autrice.
M : C'est clair. Donc, pour vous tout seul, là, il y a ce roman sur la Reconquista. Ce sera le prochain ?
JLDS : Ce sera le prochain. Je ne sais pas si j'ai donné le nom, je peux le donner, c'est : Du roi je serai l'assassin. Ce sera l'histoire de Silas, ce personnage secondaire de Royaume de vent et de colères. Il y a plein de gens qui me disent "on voudrait en savoir plus", je ne savais pas comment faire, parce que la façon dont il est dans le roman ne marche que par très petites fenêtres, je pense qu'on ne peut pas en faire un roman comme ça, avec cette approche littéraire-là. J'ai trouvé un moyen de faire différemment. Et du coup il sera installé entre Grenade – à la fin de la Reconquista, d'où il est originaire, donc un enfant mauresque, converti de force au catholicisme, mais qui continue en cachette à pratiquer, comme il y en a eu plein après cet évènement-là – et Montpellier avec son université de médecine et les guerres de religion qui commencent quasiment juste après. Moi, j'aime bien les OVNI littéraires, on le sait. Le format d'écriture, ce sera à la fois un préquel à Royaume de vent et de colères, mais aussi une suite. Vous aurez les deux en un ! Mais c'est aussi et d'abord l'histoire de Silas, qui est un personnage assez cruel, on ne va pas se mentir : on parle d'un assassin et d'un tueur. Mais il est bien né quelque part, il a bien grandi quelque part, il a bien pleuré quelque part.
M : Oui, et puis c'est un personnage qui a un potentiel énorme, et ç'aurait été dommage de ne pas le reprendre. Il est fascinant, ce personnage-là.
JLDS : Merci. Après, il y a eu une double difficulté d'écriture : la première, c'est que je n'avais rien prévu d'en faire... plus, que le roman, et la seconde, encore une fois, il apparaît de façon très ponctuelle dans Royaume de vent et de colères. Est-ce qu'il y a capacité à le faire vivre ? Alors pour des nouveaux lecteurs, ce n’est pas un problème, parce qu'ils ne connaissent pas, en fait. Mais comment fait-on vivre Silas aux gens qui ont lu le roman, comment on fait vivre ce personnage-là différemment, avec autant d'intensité ? C'est compliqué. C'est pour ça que j'ai mis un moment pour trouver la solution technique. Et ça va demander, encore une fois, un travail d'écriture singulier. Je n'entre pas dans le détail. Là pour le coup, je remets la main à la pâte sur l'écriture. Parce qu'après ces trois romans, c'est cette question-là, c'est "et maintenant, comment je fais évoluer mon écriture ?" C'est dur ! Je rame, c'est compliqué pour moi d'écrire, c'est compliqué de progresser, donc maintenant comment je fais ? Je fais des formations en scénario BD, je vais chercher sur d'autres media, je m'essaie à la jeunesse, à travailler avec un illustrateur... Qu'est-ce qui alimente, maintenant, une écriture ? Il ne faut pas s'endormir.
M : Et ça, j'ai trouvé ça très perceptible dans Je suis fille de rage.
JLDS : C'est vrai ?
M : Ah oui, vraiment ! Justement, vous parliez de l'écriture, quel est votre rythme d'écriture ? Est-ce que vous avez des rituels d'écriture ? Comment est-ce que Jean-Laurent Del Socorro écrit, concrètement ?
JLDS : Je n'ai pas de rituel d'écriture. En fait, je suis très pragmatique : j'ai une activité professionnelle, il faut que j'écrive dans les interstices de ma vie, tout en gardant une vie personnelle à côté : je suis grand consommateur de danse, de théâtre, j'ai besoin de ça aussi, ça me nourrit, puis j'adore ça, on ne va pas se mentir. La seule nécessité que j'ai, dans les moments d'écriture quand je suis devant la feuille, c’est d’écrire, je n'ai pas le choix. Alors, comment fait-on pour ne pas avoir de page blanche ? Comment fait-on pour écrire quoi qu’il arrive ? Brandon Sanderson disait, dans une de ses master classes en ligne, "l'écriture ce n'est pas du talent, ce n'est pas de la chance, c'est de la compétence". C'est exactement ça : on devient écrivain sur cette compétence-là. C’est se dire "j'ai besoin d'être devant une feuille à des moments T, j'ai besoin d'écrire, ce n'est pas une question d'inspiration, c'est rien... Il faut que j'écrive !" C'est pour ça que je pense que je suis allé spontanément vers ce qui me va, une écriture sans plan, une spontanéité qui nécessite beaucoup de re-travail, beaucoup de coupes, mais finalement qui permet à tout instant de produire quelque chose. Et si rituel il y a, c'est la méthode de travail d'avoir toujours un groupe de relecteurs, et un lecteur spécialisé sur ma période historique, qui me valide au moins un canevas pour que je ne sois pas trop en-dehors des clous, parce que sinon ce serait compliqué, je pense, pour moi. Mais non, pas de rituels, j'écris sans musique, j'écris, point. Je n'attends pas l'inspiration.
M : Chaque auteur a sa façon, en fait. Est-ce que vous avez des influences littéraires ou stylistiques qui seraient reconnaissables, identifiables pour vous ?
JLDS : Alors, stylistiques, non, parce que je ne peux pas le prétendre... Il y a quelque chose d'important, que je redis souvent : je suis un scientifique à la base, donc le littéraire, même si je suis un gros lecteur, c'est dur pour moi. Je suis très dyslexique. Il faut savoir que je passe une partie de mon temps aussi à remettre les mots droit, ça fait rire les gens, mais je pense que les dyslexiques compatiront avec moi, ont eux aussi cette difficulté de produire très vite, ce qui nécessite aussi de se relire beaucoup. Et donc il y a quand même déjà un aspect, de base, d'écrire... L'écriture, j'adore ça , mais elle ne m’est pas facile, voilà. Je compare ça à un ami qui fait de la radio alors qu'il a un zézaiement. Je pense qu'il y a de ça, de se dire "on va sur le truc qu'on veut battre", sur lequel on veut se prouver quelque chose.
M : On surcompense
JLDS : Exactement, on surcompense. Et donc, non, je n'ai pas la capacité à me dire je vais faire un style ou pas, déjà j'écris, c'est déjà bien. Je le dis avec humilité, j'essaie juste d'écrire. Et pour les influences, après c'est un peu au gré de mes lectures, mais c'est vrai que moi j'ai commencé avec du Lovecraft, revenir sur du fantastique pur, c'est quelque chose que j'aime bien. Dans les écritures récentes, j'aime bien celles d’Alan Moore, les univers à la Gaiman, par exemple. J'adore... récemment, j'ai eu le plaisir de la rééditer À la pointe de l'épée, d'Ellen Kushner. Je pense que s'il n'y avait pas eu À la pointe de l'épée, il n'y aurait pas eu Boudicca, par exemple. Je pense que le traitement du personnage de Boudicca aurait été radicalement différent, parce qu'elle a un rapport... Elle a posé un fondamental sur le rapport aux personnages gays dans la littérature de fantasy comme il n'y en avait pas eu avant. C'était une des premières, je pense, vraiment c'était un symbole
M : Oui, avec Francis Berthelot
JLDS : Avec Berthelot, en France, avec Rivage des intouchables. Oui, tout à fait, oui elle n’était pas la seule, c'était une des pierres importantes.
M : Mais c'était une des premières, en effet.
JLDS : Et peut-être finalement cette forme de réalisme magique qui m'attire le plus, je pense, de plus en plus. Peut-être sur les nouvelles... Là j'ai recroisé Ariane Gélinas. Il y a quelque chose de fascinant dans son écriture. Je ne sais pas si ça m'inspire, mais ça me montre "Ah, voilà ! Oui, on peut aller sur ça ! On peut aller sur cette forme-là" Je dis souvent deux choses : un, je suis pas un écrivain, je ne suis pas un auteur, je suis un réauteur, je réécris beaucoup, et deux je suis avant tout et d'abord un lecteur. Je pense que plein d'auteurs seront d'accord avec moi : on est d'abord un fan et un lecteur. Et de tout : je lis du manga, de la BD, de la littérature générale... Je pense que ça nourrit sa propre écriture.
M : Merci.
JLDS : Merci à vous.
Photo ActuSF.
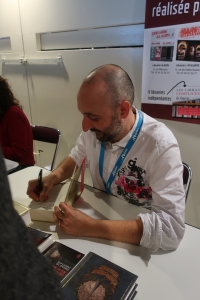
Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.