Cette interview a été réalisée pendant les Utopiales, avec l'aide des éditions Alire.
Mureliane : Eric Gauthier, bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview pour Les Chroniques de l'Imaginaire.
Eric Gauthier : Ça me fait plaisir.
M : Vous venez de publier en France... enfin, au Québec, mais...
EG : ...maintenant disponible en France, oui.
M : Le Saint Patron des plans foireux. Qu'est-ce que vous en diriez, vous ?
EG : Mmmm. J'en dirais que c'est un roman avec lequel je me suis bien amusé, donc j'espère que les lecteurs vont s'amuser aussi. C'est mon plus comique jusqu'ici. J'ai des modes plus sinistres dans certaines œuvres. Avec celui-là, il y a des petits aspects sinistres mais il y a une bonne place aussi à l'humour qui découle des personnages, des situations. Vous voulez que je résume l'histoire, un peu ?
M : Vous dites ce que vous voulez.
EG : Essentiellement, c'est l'histoire d'une combine qui dérape : une histoire de trafic de reliques, du trafic du squelette d'un saint, une pièce ornée de bijoux, absolument spectaculaire. On suit un petit escroc qui essaie d'obtenir et de revendre la pièce, et puis se la fait enlever, et qui la voit réanimée, d'où les aspects fantastiques de l'histoire. Je voulais m'amuser à introduire un élément fantastique très franc, introduire quelque chose d'un peu ridicule dans le roman, et puis ensuite voir qu'est-ce qui découle de ça. Les choses deviennent très compliquées pour notre vendeur de squelette. Les choses prennent une tournure légèrement surréelle pour lui, une tournure dangereuse, évidemment. Et puis il apprend des choses en cours de route.
M : Comment vous est venue l'idée de ce roman ? D'où est-ce qu'il vient ?
EG : C'est un peu des choses différentes. Je me rendais compte que mes romans s'écrivent souvent par... accrétion, disons : j'ai une idée par-ci, une idée par-là, puis on dirait que j'arrive pas à me résoudre à prendre une seule idée pour la développer sur la longueur d'un roman. Donc dans ce cas-ci, un déclencheur ça a été la lecture d'un article dans le Fortean Times, une revue en partie inspirée par les écrits de Charles Fort, qui lui s'était fait chercheur de l'insolite, disons, et qui documentait des pluies de grenouilles, des choses comme ça. Et le Fortean Times a des articles sur des phénomènes anormaux, mais aussi des articles qui ont une portée... simplement une portée historique, et qui sont bien documentés. Et puis ils avaient un article sur les... sur ce qu'ils appellent les saints des catacombes, des squelettes qui ont été retrouvés dans les catacombes romaines peu après Martin Luther et ses 95 thèses, après que le protestantisme naissant ait fait des... ait entre autres, par la bande, causé des saccages dans des églises allemandes. Donc à Rome ils retrouvaient des squelettes qu'ils croyaient être des squelettes de martyrs, et puis ils les envoyaient dans des églises allemandes où ils étaient décorés somptueusement pour re-décorer les églises, redorer le blason de l'église catholique là-bas. C'est un article de Paul Koudounaris, dont j'ai lu le livre ensuite sur le même sujet. Je savais que je voulais explorer ça. J'ai toujours été intéressé par les questions de croyance, de religion. Je suis pas vraiment religieux moi-même, mais pas athée militant non plus, j'aime les zones d'ambiguïté, je crois. Et puis surtout j'aime réfléchir à la manière dont notre cerveau fonctionne, et à la manière dont nos croyances orientent nos vies, ou à la manière dont nous on peut orienter nos croyances - parce que sinon d'autres vont le faire pour nous. Un autre élément derrière l'écriture du roman, c'est que j'avais envie de trouver une manière de dire le monde dans lequel on vit ces dernières années, un monde qui me paraissait de plus en plus... pas exactement chaotique, mais un monde qui me semblait déraper de différentes manières. J'avais envie de parler de ça, et ça m'amenait dans des terrains très sérieux, et quelque peu déprimants, et peut-être en réaction à ça, il y a un humour certain qui s'est immiscé dans le roman.
M : Vous êtes Québécois francophone ?
EG : Oui.
M : Quel rapport vous avez à l'anglais ?
EG : En partant, le rapport de la plupart des Québécois. J'ai grandi dans une région du Québec qui s'appelle l'Abitibi-Témiscamingue, qui est dans l'Ouest, et puis un peu vers le Nord, et qui partage une frontière avec l'Ontario, la province à côté qui est surtout anglophone. Mais au Québec en général on est... comme on est en pleine Amérique du Nord, on est entourés par des anglophones, et puis par des pingouins, et puis enfin... On a adopté beaucoup de termes anglais dans notre vocabulaire, des expressions... Moi personnellement, dans ma famille on m'a inculqué que c'était utile d'apprendre l'anglais. On était... peut-être que ça aidait qu'on était proches de l'Ontario, mais plus généralement le bilinguisme effectivement me semble très utile pour comprendre tous ces Nord-Américains anglophones qui nous entourent. Et puis, à cause de ça j'ai commencé à apprendre l'anglais, puis à bien l'apprendre, assez tôt, et du moment que j'ai découvert les littératures de l'imaginaire, avec des auteurs comme Bradbury, comme Asimov, Lovecraft aussi, puis j'en passe, j'ai vite eu le goût de lire ces auteurs-là dans la langue originale, donc je me suis mis à lire en anglais assez tôt aussi.
M : Mais vous écrivez uniquement en français ?
EG : Oui. Ça c'est un choix très conscient. J'ai écrit une courte histoire ou deux en anglais. En fait, j'ai des contes... Etant conteur aussi, et étant bilingue, je me suis arrangé pour conter dans des festivals anglophones à l'occasion. J'ai traduit certains de mes contes en anglais. Mais essentiellement j'écris d'abord en français, et c'est vraiment un choix de m'adresser à mes compatriotes simplement. J'avais envie... Parce que ce que j'écris, c'est une manière de décrire ce que je vois autour de moi, c'est une manière de rire de nous, par moments, c'est une manière de parler de nos craintes, aussi, tout ça. Et je voulais d'abord que ça puisse être lisible par les gens qui m'entouraient. Et par la suite je suis très heureux si ça a plu à des lecteurs français aussi, des lecteurs européens, des lecteurs de n'importe où.
M : Justement, c'était une question que je me posais : votre profession, c'est conteur ? Ou est-ce que le fait de conter est une autre partie de votre vie ?
EG : Ma profession, c'est écrivain et conteur. J'ai... à peu près depuis mes débuts, j'ai présenté les deux sur un... sur un pied d'égalité, disons. Et puis les deux me semblent relever... me semblent pousser à partir de mêmes racines : c'est l'amour des histoires, c'est trouver des manières de raconter. J'ai découvert le conte un peu plus tard que j'ai découvert l'écriture, mais... J'ai commencé à conter au moment où je commençais à avoir mes premières publications professionnelles en revue, dans la revue Solaris. Et puis, d'une année à l'autre, je consacre moins de temps à l'écriture, ou plus ou moins de temps au conte, ou... Ça a toujours fluctué, pour moi. Je suis nettement plus dans l'écriture, ces dernières années, mais le conte m'habite encore.
M : Oui, et je me demandais, du coup, comment ces deux activités se nourrissaient réciproquement, ou se grignotaient réciproquement ? Comment ça se joue entre les deux, qui sont proches et différentes à la fois ?
EG : Déjà, je me suis embarqué dans les deux parce que je me rendais compte que les deux activités me nourrissaient, moi, de manières différentes. L'écriture me permet de fignoler longuement un texte, d'écrire sur des centaines de pages si ça me tente, de bien explorer un univers ; tandis que le conte me permet l'immédiat, me permet d'être face à mon auditoire, de les regarder dans les yeux, de leur livrer mes histoires et puis de voir tout de suite si ça marche ou non, d'ajuster le tir, si je veux, et puis de raconter différemment la prochaine fois. Donc les contes, eux, restent vivants pour moi, d'abord, en évolution. Je trouve vraiment qu'il y a certains avantages distincts à une approche et l'autre, à l'écriture et à l'oral. Maintenant, comment les deux se nourrissent... déjà, c'est certain que ma manière de conter a été influencée par mes lectures de fantastique, et puis plus tard aussi par mon écriture de fantastique, donc j'explore pas nécessairement les mêmes thèmes que la plupart des autres conteurs au Québec, ou je le fais pas avec la même approche. Ça s'est contaminé, par moments, aussi. Le dernier spectacle solo que j'ai composé, je l'ai composé essentiellement d'un bloc, plutôt que de grappiller une histoire par-ci, une histoire par-là et puis de les rafistoler en un tout : là je voulais que tout se tienne. Et puis j'ai approché l'écriture de ce spectacle-là un peu comme j'approche celle d'un roman. Ce qui fait que j'ai produit une fois et demie la quantité de matériel dont j'avais besoin, j'ai dû couper. Ça m'a avantagé parce que le spectacle était plus cohérent mais ça m'a compliqué la vie aussi. Donc il y a des avantages et des inconvénients.
M : Comment est-ce que vous avez commencé d'écrire ? Et quand, d'ailleurs ?
EG : Je me suis intéressé aux histoires depuis toujours. Quand j'étais tout petit, je lisais, ou j'avais hâte de pouvoir lire, je rédigeais des petits livres, mais bon... Au secondaire, disons autour de l'âge de dix-sept ans, on était obligé d'écrire une nouvelle littéraire, ça faisait partie du programme pour cette année-là. J'ai remis la mienne, mon prof m'a donné une note de 81 pour cent, avec une note qui disait "style singulier". Et ça, je savais que ça voulait dire qu'elle avait pas aimé ma nouvelle mais qu'elle lui reconnaissait une valeur, qu'elle reconnaissait que j'avais du style. Après cette nouvelle-là écrite par obligation, j'ai continué à écrire pour le plaisir, co-fondé une revue littéraire au cégep, donc juste avant l'université. Et puis en faisant ça, j'ai appris au contact d'autres jeunes qui écrivaient nettement mieux que moi, qui écrivaient à un niveau essentiellement professionnel, eux, déjà. Et puis j'ai continué. J'ai travaillé... j'ai eu un "vrai travail", pendant quelques années, après l'université, mais pendant tout ce temps-là j'écrivais de plus en plus. Je sais pas, je saurais pas dire c'était quoi l'impulsion initiale, mais je dirais le goût d'explorer des imaginaires. Ç'a été beaucoup... ç'a été une grosse portion. J'ai toujours aimé les littératures de l'imaginaire, c'est ça que j'ai spontanément voulu écrire.
M : D'ailleurs, vous citiez tout à l'heure Asimov, Bradbury et Lovecraft. Est-ce que vous diriez qu'ils ont été des influences pour vous ? Ou des modèles ? Ou sinon, est-ce que vous pourriez citer, éventuellement, des auteurs que vous auriez eu envie d'émuler ?
EG : Ces trois-là ont été des influences certaines pour moi. Peut-être Bradbury en particulier, pour son sens du merveilleux, disons... sa langue imagée, aussi, sa manière d'écrire, de tourner les phrases, et puis son petit côté sinistre et cruel par moments : autant il peut écrire une histoire au sujet de l'enfance qui est pleine de champs en fleurs et puis de l'odeur de la tarte aux pommes et pis tout ça, autant il peut écrire une histoire affreuse où est-ce qu'un homme se retrouve sans os, tout flasque... J'aimais cette versatilité-là. Sinon, plus tard, un auteur qui a été particulièrement marquant par son écriture, et un peu comme modèle généralement aussi, ç'a été Neil Gaiman. Pour le genre d'histoires qu'il raconte, sa manière de faire se rencontrer les vieux mythes et la modernité, sa manière de sortir de la page, aussi, si on veut : il a endisqué un album, il y a longtemps, où est-ce qu'il lisait de ses textes, donc il avait envie déjà d'apporter une dimension orale. C'est un excellent lecteur de ses textes, pour l'avoir vu en personne, et il est très bon aussi avec son auditoire, il est gracieux. Ça, je peux pas dire que j'ai atteint ça moi-même encore, mais j'essaie d'en tirer exemple.
Une chose que j'ai remarquée déjà en pensant à mes influences, c'est que les auteurs québécois sont arrivés sur le tard, pour moi, pour m'influencer. En partie, je crois, parce que quand j'étais enfant et puis que je commençais à découvrir les littératures de l'imaginaire, il s'en publiait pas tant, au Québec, en français, ou il n'y en avait pas tant à ma bibliothèque locale, alors que maintenant il y a une belle offre. Il y a des gens, des lecteurs, maintenant, qui ont grandi à fond en lisant des auteurs québécois. Mais c'est certain que pour les avoir lus éventuellement, puis les avoir côtoyés dans notre congrès annuel, le congrès Boréal, au Québec, j'ai été influencé de diverses manières par Élisabeth Vonarburg, par Joël Champetier, Yves Meynard pour sa plume, pour sa manière de travailler avec les mots, un petit peu son côté presque contradictoire, aussi, d'utiliser des fois des éléments classiques mais de passer bien à côté du cliché.
M : Oui, il fait ça très bien dans sa dernière publication, Chrysanthe.
EG : On le voit bien là-dedans, oui. Et puis je pourrais nommer la moitié des auteurs québécois des littératures de l'imaginaire. J'ai appris beaucoup à leur contact.
M : De ce que j'ai pu comprendre de votre site Internet, et de ce que vous disiez tout à l'heure, vous créez vos contes. Est-ce que ça a toujours été le cas, ou est-ce que vous avez commencé avec les contes classiques, type Perrault ou Andersen ?
EG : Le premier conte que j'ai écrit, je savais pas que c'était un conte exactement. C'est La Tribu du Douzième - qu'on peut lire encore sur mon site, je crois - qui est une histoire de résidence universitaire. Je partais de mon vécu, je lui donnais une dimension pratiquement mythique et puis j'avais tourné ça un peu avec des tournures de phrase tirées des vieilles légendes, il y avait un côté, surtout en arrivant vers la fin de l'histoire, il y avait un petit côté ronflant de la narration. Ça, c'est quand j'habitais à Ottawa pour l'université. Quand j'ai déménagé à Montréal ensuite, et que j'ai découvert qu'il y avait des soirées de conte dans un bar chaque semaine, ce à quoi j'avais pas été exposé encore, j'ai voulu m'essayer à raconter moi aussi, puis c'est cette histoire-là que j'ai apprise et que j'ai racontée sur scène. Ç'a été mon premier conte. Ça a vraiment donné le ton, parce que pendant toute ma carrière après j'ai été dans le conte contemporain, le conte de création, du conte qui soit fantastique, ou dans le merveilleux, mais dans l'urbain, dans le moderne, toujours. J'ai deux-trois contes traditionnels à mon répertoire, que j'ai adaptés, et puis même ceux-là, je les adapte d'une façon un peu non conventionnelle.
M : Je ne connais évidemment pas votre activité de conteur, mais ce qui m'a frappée dans les trois romans de vous que j'ai lus, c'est la prégnance de l'environnement urbain. Surtout dans Montréel, évidemment, mais également dans les autres. Vous êtes un gars des villes ?
EG : Je suis un gars de ville. Comme je vous disais, je viens d'Abitibi qui est vue comme une région éloignée, une région minière, une région de forêts, mais j'ai quand même grandi dans les villes là-bas, j'ai longtemps habité dans LA grande ville de la région, qui est pas énorme, mais... Je crois que j'aime le croisement d'influences qu'on rencontre dans les villes, le foisonnement intellectuel, culturel. J'ai déménagé... je suis allé à Ottawa pour l'université, c'était surtout pour le programme universitaire, mais la grande ville m'attirait, et puis ensuite il fallait que ce soit Montréal, je voulais revenir au Québec et c'est une métropole qui me convenait spontanément, je me sentais chez moi. Donc ouais. Là, je suis rendu à Sherbrooke, c'est plus petit, mais ça reste une ville, une réelle ville.
M : C'est combien d'habitants, à peu près ?
EG : Autour de cent, cent cinquante mille, comme ordre de grandeur. Donc voilà, j'aime pouvoir croiser toutes sortes de gens. Je pense que j'aime l'anonymat, un peu, en partie pour pouvoir juste me perdre dans les rues et puis avoir l'impression de pas avoir de comptes à rendre à personne parce que personne me remarque, ou personne... ce qui est pas toujours vrai, parce qu'à Sherbrooke, dans le centre-ville, je tombe toujours sur quelqu'un que je connais, on fréquente les mêmes endroits, mais bon...
M : Jusqu'à présent, selon les informations que j'ai, vous n'avez écrit qu'en fantastique. Est-ce que vous pensez changer ?
EG : J'ai écrit un peu de science-fiction sous forme de nouvelles, ça commence à faire un certain temps déjà, la dernière remonte à longtemps déjà. J'avais le goût de ce genre-là aussi mais, probablement en bonne partie parce que je me suis lancé dans le conte en parallèle, l'univers du conte me rapprochait du fantastique. Disons que la science-fiction est nettement plus difficile à raconter. Il y en a qui le font, mais en règle générale le fantastique se prête mieux à être raconté. Et puis évidemment dans mes confrères et consœurs qui contaient autour de moi, il y en a beaucoup qui donnaient dans le traditionnel, et puis je me nourris du traditionnel, même si je le raconte presque pas moi-même. Et je sais pas... il y a un petit peu de paresse aussi là-dedans, dans le sens où la science-fiction peut souvent demander un plus gros travail d'extrapolation, de construction de monde, etc. Mais je l'oublie pas. Il me vient périodiquement des envies de revenir à la SF. Je sais pas quelle forme ça prendrait, là, mais ça peut arriver.
M : Et justement, qu'est-ce que vous travaillez, à l'heure actuelle ?
EG : Je me suis offert le luxe - ou l'erreur, allez savoir - de me lancer dans une histoire sans visée de publication précise. Je me suis lancé sans savoir si ça allait devenir une longue nouvelle, ou un roman, sans savoir où j'allais soumettre ce texte-là au bout du compte. C'est dans une forme de fantastique encore. C'est une histoire qui parle du temps, et puis comment est-ce qu'on vit avec le temps, avec l'idée de notre avenir, des choses comme ça. Je suis assez curieux de voir où est-ce que ça va aboutir !
M : Eh bien, on va laisser du temps au temps, et s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie, Eric Gauthier.
EG : Ça m'a fait plaisir.
Copyright photo : Jean-François Dupuis. Pour en savoir plus et suivre l'actualité d'Eric Gauthier, vous pouvez vous inscrire à son infolettre.
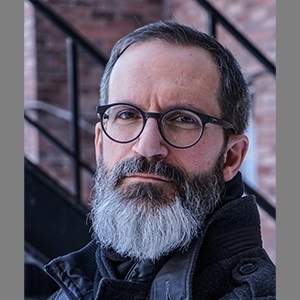
Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.