Ce numéro de la revue est assombri par le décès soudain de Jean-Pierre Laigle, qui s'était précisément chargé du dossier des Babels du Futur, les habitats science-fictifs au centre de ce numéro. Un hommage lui est donc rendu, et les lecteurs de l'édition électronique pourront de surcroît découvrir sa vision d'une géopolitique futuriste, mais qui m'a paru crédible, dans sa nouvelle Treize milliards de tonnes de CO2, qui se déroule en 2084.
Je dois avouer que celle que j'ai le plus aimé parmi les nouvelles proposées n'est pas la lauréate du Prix Alain Le Bussy 2020 : j'ai trouvé bien écrite L'esprit perdu, de Pauline J. Bhutia, qui met en scène les dangers, pour un esprit rationnel et obsédé par la performance en solitaire, de la communication groupale sans filtre, mais le thème ne m'a pas paru spécialement original. Mais peut-être ce texte a-t'il, en ce qui me concerne, souffert de sa proximité avec Noeuds et torsades, de D.A. Xiaolin Spires, qui décrit trois façons d'être femme, aux USA et à Taiwan, dans un futur indéterminé, et dont j'ai bien aimé l'originalité, précisément, avec cet alliage très chinois de tradition et de modernité.
Le thème du retour (très) atavique, ou plus largement du lien avec la nature, est illustré, de façon très différente, mais avec un égal bonheur, par Les chants que l'humanité abandonna aux dauphins, de Schweta Taneja, où l'on voit des petits humains repartir vers la mer, et Mue cotonnière, de Bernard Henninger, où il y a des mues, et des marques animales, plus désirables que d'autres, dans un monde intéressant, dont je regrette la nécessaire brièveté.
Incontestablement, la nouvelle que j'ai préférée dans la revue est Technokarma, de Lalex Andrea, où l'on assiste au réveil d'une belle jeune femme dont l'âme ancienne vient de transmigrer, grâce à la technologie, dans un nouveau corps. Outre l'originalité du thème, la grande sensorialité de l'écriture, la progression bien maîtrisée de la nouvelle, et sa chute très inattendue m'ont totalement séduite. Je ne peux que plaindre les lecteurs de l'édition papier, qui en seront privés.
Il m'a manqué des détails concrets pour entrer émotionnellement dans Salissure, de Rich Larson, pourtant originale et intéressante, et je crains d'être passée très à côté d'Ombre perdue, de Patrice Lajoye, et de n'avoir pas de grand souvenir de Journal d'un Humanoïde, de Jean-Jacques Jouannais.
Le dossier sur Les Babels du Futur, élaboré, donc, par Jean-Pierre Laigle, est très instructif, au sens où il regroupe une bonne variété de textes sur le thème de la ville-univers, ou de la Tour totale, lieu de vie de la naissance à la tombe. Si certains, comme Les monades urbaines, de Robert Silverberg, viennent immédiatement à l'esprit, d'autres, surtout les plus récents, sont beaucoup moins connus, et je prévois de m'y intéresser de plus près. Ce dossier est illustré par trois nouvelles consacrées au sujet, très différentes l'une de l'autre, et qui suffiraient à démontrer la persistance et la vitalité du thème, puisque La fille de la sous-ville, de Jean-Louis Trudel, décrit un univers essentiellement maritime, avec une ville partiellement sous-marine, La citadelle de la honte, de Micky Papoz, peint une sorte de gigantesque Las Vegas vertical, où les plus riches peuvent se livrer aux sept péchés capitaux, et Au plus profond du ciel, d'Ariane Gélinas, explore les sous-sols des grandes tours imaginées par Silverberg, en une inversion qui donne le vertige. Une interview de l'auteur américain par Jean-Pierre Laigle complète ce dossier.
Ce numéro de la revue était complété par un article sur le musicien Klaus Schulze, par Jean-Guillaume Lanuque et Jean-Michel Calvez, et un autre sur l'auteur Max-André Rayjean, par Richard D. Nolane, et par les habituelles critiques de livres et de BD. Pas de films, confinement et fermeture des cinémas oblige !
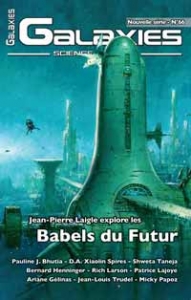
Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.