Ce roman fait partie d'un cycle, Le rêve du démiurge, dont est chroniquée ici la récente publication au format électronique sans DRM. Le prix total de cette intégrale, qui compte 9 romans, est de 27€.
Tous les adeptes, et le leader, de l'Ordre du Fer Divin se sont immolés par le feu. Le seul survivant est un adolescent de douze ans, Kantor Ferrier. Après deux ans passés à décourager de son "cas" services sociaux et psychiatres, il est enfin confié à sa tante, l'actrice Muriel Ortan.
Octave Angernal, glacé par l'ombre que lui porte involontairement son père, Yann Angernal, grand psychanalyste et philosophe, est aussi solitaire que Kantor. Inévitablement, les deux garçons vont se lier, jusqu'à ce que le rapprochement de Kantor et du père Angernal, impardonnable aux yeux d'Octave, les sépare.
La mort de Yann Angernal va propulser les deux jeunes gens chacun vers son propre extrême.
Ce roman où se font face le blanc et le noir, la glace et le feu, est bien moins manichéen qu'on ne pourrait le craindre, et cela seul suffirait à révéler, s'il en était besoin, la subtilité de son auteur. Il semble être une étude d'opposés, qu'il s'agisse des genres ou du Bien et du Mal. Ainsi, les femmes y font figure de victimes, ou de sacrifices, qu'il s'agisse des épouses, Nadia et Claire, ou de la lumineuse et forte Iris, là où les hommes sont origine et moteur de l'action, mais sont néanmoins contrés, ou continués, par leurs épouses.
Une autre paire en opposition, temporelle cette fois, est celle des pères et des fils, amplifiée par Kantor en opposition entre le Créateur et la créature. On voit donc que le "clan" apparent des hommes est moins monolithique qu'il ne pourrait sembler au premier abord, et le personnage de Gaspard rééquilibre une galerie qui sans lui pourrait évoquer une caricature, de la même façon que Muriel semble de plus en plus une incarnation d'une force décidément féminine. En fait, plus on avance dans le roman, et plus on se rend compte qu'il est une réflexion sur l'ambivalence, au sens où ces paires d'opposés sont cela précisément : des paires, ce que la fin démontre à l'évidence, qui nous présente Octave et Kantor comme dorénavant inséparables.
Un autre thème important du cycle, celui du pouvoir, est ici au centre. Si Kantor a hérité le sien de son père, il ne l'utilise pas - toujours - de la même manière, et la fin montre bien qu'il est des façons de l'utiliser qui s'opposent à sa nature trop fondamentalement pour être tolérables. Fercaël jouit de son pouvoir, en use et en abuse, comme le fait Velasco, plus sournoisement. Le cas de Yann Angernal est plus ambigu. Il pose le problème moral, inévitable, de l'effet que nous pouvons avoir sur notre entourage, volontairement ou non, consciemment ou non, et c'est l'un des éléments que j'ai beaucoup aimés dans cette histoire que de ne pas trop éclairer les possibles pans d'ombre d'un caractère apparemment lumineux, pour ne pas dire "angélique".
On retrouve ici les personnages rencontrés au départ dans L'ombre d'un soldat, ainsi que certains mis en scène dans Mélusath. Plus long roman du cycle jusqu'à présent, il en occupe le centre, et, d'une certaine façon, me semble en présenter toutes les caractéristiques : lyrisme et précision du style, imagination très personnelle de l'auteur dans la représentation des mondes intérieurs de chacun, et de leurs manifestations, fantastique discret, uniquement représenté ici par le pouvoir de Kantor, tout ceci s'appuyant en l'occurrence sur une construction solide, avec ces trois parties chacune divisée en onze chapitres. Les grandes incantations et lamentations du Requiem scandent tout le roman, à commencer par le titre, qui y fait une allusion assez typiquement inversée. Il peut se lire seul, mais on en appréciera mieux l'arrière-plan en ayant lu au moins les deux romans sus-cités.
A l'occasion de la publication de l'intégrale du cycle (9 romans) en e-pub sans DRM, l'auteur et l'éditeur offrent un exemplaire papier et deux exemplaires numériques de l'intégrale pour notre concours de l'été 2020.
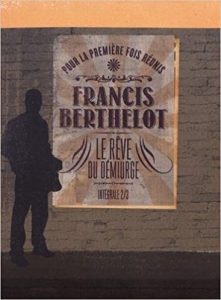
Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.