L'Œsthrénie, vous connaissez ? Un petit pays des Balkans, quelque part du côté de la Roumanie, mais pas tout à fait. On serait tenté d'ajouter « sans histoire », mais bien au contraire, c'est une contrée chargée du poids des ans et des guerres contre l'envahisseur, qu'il soit autrichien, turc ou roumain. Un petit pays pas tout à fait comme les autres, partagé entre ses basses terres et ses montagnes, entre rustres et civilisés, entre bons chrétiens et hérétiques, entre plaines cultivées et forêts embrumées où rôde on ne sait trop quoi. Mais un petit pays un peu comme les autres quand même, dont l'histoire rappelle celle de ses voisins, de la petite principauté endormie de la fin du dix-neuvième siècle à la dictature militaire moderniste de l'entre-deux-guerres.
Dernières nouvelles d'Œsthrénie est un recueil de six longues nouvelles qui se déroulent dans le pays du même nom, pays de fiction que la préface de Yves et Ada Rémy s'amuse à présenter comme impossiblement réel. Chacune suit un narrateur différent et prend place à une époque différente, mais les échos sont nombreux entre elles, qu'il s'agisse de personnages, d'objets ou d'événements, ce qui donne chair à l'Œsthrénie et à ses habitants.
En lisant le résumé de l'éditeur et la préface, je m'attendais à une sorte de romance ruritanienne remise au goût du jour, une sorte de Prisonnier de Zenda ou de Kœnigsmark post-moderne. De fait, la première nouvelle, La Boucle, se déroule à la même époque que les romans d'Anthony Hope et de Pierre Benoît, cette période juste avant la Première Guerre mondiale où l'Europe des têtes couronnées est au sommet de sa gloire. Néanmoins, Anne-Sylvie Salzman s'écarte de ces modèles de plusieurs manières significatives, notamment en ayant pour narratrice une femme, Aszhen, la fille du baron de Zelenka.
L'Œsthrénie n'a également rien d'une petite principauté d'opérette, c'est un pays à l'histoire tourmentée qui continue à peser sur son présent et où les barons de Zelenka, récemment anoblis, font un peu figure d'usurpateurs. À leur cour gravitent des personnages comme le savant anglais Finlay ou le régisseur Juras, qui semblent inspirés des archétypes du genre (le savant farfelu, le beau ténébreux), mais n'y collent pas exactement et suscitent même un léger malaise par leur comportement. Ce mot de malaise résume bien l'atmosphère de cette première nouvelle, où l'on ne sait jamais vraiment où nous entraîne la narratrice, avec ses non-dits souvent chargés d'un poids aussi lourd que nébuleux. J'ai vraiment été séduit par ce texte.
Plusieurs décennies s'écoulent entre La Boucle et les autres nouvelles du recueil, qui se suivent de manière plus resserrée. Leurs figures centrales sont deux frères, Akmat et Lucian, impliqués malgré eux dans les affaires politiques d'une Œsthrénie devenue république, en réalité à la botte du dictateur Hradzic. Lucian est son architecte attitré et travaille à la construction de son palais ; Akmat rentre d'exil pour participer à un coup d'État. On quitte pour de bon l'ambiance post-ruritanienne de la première nouvelle et même si ce trouble indéfinissable est toujours au rendez-vous, ces textes m'ont moins convaincu.
Mon principal bémol vis-à-vis de ce livre serait son style. Il est souvent très beau, mais aussi singulièrement haché, avec des phrases remplies de propositions relatives, du genre à vous faire vous gratter le crâne à la recherche de l'antécédent d'un pronom donné. C'est sans doute un choix de l'autrice, mais je dois dire que cela a rendu ma lecture plus pénible que je ne m'y attendais.
Je ne regrette cependant pas d'avoir pris la peine de finir Dernières nouvelles d'Œsthrénie. C'est un ouvrage mémorable et singulier, qui mérite qu'on lui consacre un peu plus de temps et d'efforts qu'à d'autres.
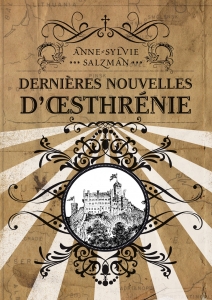
Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.