Cet ouvrage reprend certaines contributions au 31e Forum Philo Le Monde / Le Mans, rencontres philosophiques organisées du 8 au 10 novembre 2019 par la Ville du Mans et le journal Le Monde sous la direction de Jean Birnbaum.
J'ai repris en introduction le préambule de ce recueil afin de le situer dans son contexte. Il regroupe des textes d'auteur.e.s de disciplines différentes, politologue, philosophes, sociologue, écrivain.e.s, etc. Cette richesse de références et d'approches permet de rendre à ce terme d'identité, qui pourrait sembler univoque à l'heure présente, une épaisseur, une variété, un "moiré", pour reprendre le terme de Charles Dantzig dans sa contribution (Pour une pensée moirée).
A ce propos, il me paraît à la fois symptomatique et inquiétant que la seule contribution qui ne se donne pas la peine de définir le terme, et qui soutienne d'ailleurs à la fois que cela n'existe pas, et qu'on peut s'en passer, ce qui n'a rien de surprenant puisqu'il confond allègrement Moi et Je, émane du clavier de Jean-François Bayart, le seul politologue du recueil (L'identité, c'est comme la cigarette).
Les tentatives de définition du terme peuvent s'appuyer soit sur l'histoire littéraire et philosophique de la notion, comme le fait Claude Romano (Etre soi-même : une chimère ?), soit sur la notion différente qu'en ont les logiciens et les psychologues, comme le montre Vincent Descombes (Avons-nous une identité ?).
D'autres auteur.e.s se sont penché.e.s sur la façon dont la notion est utilisée à l'heure actuelle, par exemple dans un sens collectif plutôt qu'individuel, reprenant les notions d'appartenance et d'identification, et c'est le cas tant de Magali Bessone (Du "Je" au "Nous" : désagréger l'identité), que de Rémi Brague (Notre identité excentrique), et s'interrogeant sur le sens de cette "collectivisation" de l'identité, comme le fait Clotilde Leguil (Au-delà des identités, défendre la valeur du "Je").
D'autres enfin, outre Jean-François Bayart, se sont penché.e.s sur l'existence et l'usage de la notion d'identité dans le domaine culturel et politique. Je pense notamment à Wendy Delorme (Identité, langage et domination), Nathalie Heinich (Un outil plutôt qu'une arme) et Achille Mbembe (Vers une nouvelle conscience planétaire), qui s'intéressent aux différences identitaires, et à ce qu'on a coutume d'appeler "l'identité nationale".
Je dois dire que la vieille lectrice que je suis (au double sens de "âgée" et "de longue date") s'est particulièrement intéressée aux textes de Charles Dantzig, déjà cité, en ce qu'il met en regard la définition, souvent binaire, que pratique l'état-civil, et l'indéfinition, l'imagination, en mosaïque, que propose la littérature, et de Brigitte Ouvry-Vial (La lecture comme vecteur d'identité ? Devient-on (soi-même) en lisant ?).
Si j'ai aimé certains textes davantage que d'autres, si certains m'ont touchée plus que d'autres, je n'en ai pas moins trouvé passionnante l'entièreté de ce recueil, avec les différentes voix qu'il m'a fait entendre. Je le recommande chaudement à tou.te.s les lecteurs et lectrices intéressé.e.s par le thème, et d'autant plus en ce moment où l'histoire socio-politique présente rend encore plus urgente une réflexion plurielle et dépassionnée sur le sujet. Si certaines contributions sont plus faciles d'accès que d'autres, toutes sont parfaitement lisibles pour un.e lecteur/lectrice cultivé.e et attentif.ve. Bonne lecture !
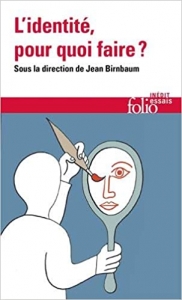
Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.