Sous-titré "Exploration scientifique et culturelle d'une planète-univers", cet ouvrage regroupe dix chercheur.se.s et philosophes autour de la saga de Frank Herbert, dont le premier tome, Dune, est sorti en 1965.
Les thèmes abordés dans cet ouvrage ne pourront que ravir les fans de l'oeuvre originale. Que l'on en juge :
Dans Les mondes de l'Imperium, Roland Lehoucq étudie les différentes planètes décrites dans la saga, de leur plausibilité géographique et climatique, jusqu'à leur possible situation, avec une hypothèse, par exemple, sur l'étoile que pourrait orbiter Salusa Secundus, et une autre sur une antérieure terraformation d'Arrakis, trop jeune pour que son état tel que présenté par Herbert au début de la saga soit naturel. Comme passer d'une planète à l'autre, et plus généralement se déplacer dans un empire inter-stellaire, suppose en effet la capacité de le faire en pliant l'espace, le même auteur en étudie la faisabilité à l'aune de la physique actuelle, dans Des plis dans l'espace-temps. Enfin, sa troisième intervention Le distille, ultime recycleur rappelle l'existence de ce vêtement indispensable à la survie à l'air libre sur Arrakis, le décrit, et évalue la façon dont il pourrait, ou non, fonctionner de la façon décrite par Herbert.
Fabrice Chemla s'intéresse, dans L'épice, un mélange bientôt disponible ?, à cet autre ingrédient emblématique du cycle et, après une description exhaustive du produit lui-même, de sa production à ses usages, en passant par ses effets, propose ici des pistes de recherche pour le rapprocher de certaines substances psychotropes actuellement utilisées, notamment pour des "voyages" chamaniques. Pour rester dans un domaine apparenté, il étudie dans La mémoire seconde : figures de la possession les différentes formes de la possession dans les cultures terriennes où cette notion existe, avant d'évoquer le cas d'Alia. Enfin, et ce n'est pas étranger aux thèmes précédents, il décrypte dans Dieu, l'empereur et le reste la totalité de la saga vue sous l'angle religieux, en prenant en compte l'ensemble des religions qui y sont mentionnées, avec, logiquement, une insistance particulière sur l'islam, qui imprègne notamment la culture Fremen. J'ai particulièrement apprécié ce regard porté sur l'ensemble du cycle de Dune, car je n'ai pas eu l'impression que c'était forcément le cas pour d'autres auteur.e.s.
Dans Arrakis et les vers géants, un écosystème global, Jean-Sébastien Steyer s'interroge sur les rapprochements pouvant être faits entre les vers des sables et les différentes familles de vers existant sur Terre, et en vient à en proposer une anatomie, avec un fort beau schéma, mais étudie aussi la vraisemblance de l'écologie d'Arrakis, avant de se pencher sur les mutations des navigateurs de la Guilde, telles que celles que Herbert dépeint au sujet d'Edric dans Le Messie de Dune, par exemple. J'ai trouvé passionnante la façon dont il met en relief les connaissances écologiques avant-gardistes de Herbert.
Dans Une histoire de trilemme énergétique, Daniel Suchet se penche sur le sujet de l'énergie, dont on sait qu'il passionnait l'auteur de la saga (ce qu'il dit du "despotisme hydraulique" vient immédiatement à l'esprit des lecteur.ice.s de son œuvre). Il y évalue l'énergie nécessaire pour la vie sur Arrakis, et la façon dont l'utilisent les différentes forces en présence. Cette étude est l'une de celles que j'ai le plus aimées, d'une part par sa proximité avec le cœur de l'intrigue humaine et géopolitique de la saga, mais aussi avec les liens qui peuvent être faits (et l'auteur, heureusement, ne s'en prive pas !) avec notre monde actuel.
Fabrice Bontemps, dans Penser l'innovation sur Arrakis, évalue qui innove dans l'histoire, et comment. Il m'a semblé que son texte ne portait que sur le premier roman, et j'avoue avoir un peu de mal avec un texte qui n'interroge pas la notion tleilaxu d'innovation, et qui ne parle pas de ce que peuvent faire les Ixiens.
Frédéric Landragin, avec Exotisme et force linguistique, décode la façon dont Herbert donne les informations à propos de son univers à ses lecteurs. Vif et plein d'humour, son texte est intéressant, même si je suis restée un peu sur ma faim dans la partie qui concerne la Voix.
J'aurais sûrement trouvé plus crédible ce qu'écrit Carrie Lynn Evans dans Femmes du futur : genre, technologie et cyborgs, si je n'avais pas eu l'impression très vive que sa lecture se bornait au premier tome. Elle décode le Bene Gesserit comme des femmes cyborgs, représentatives des fantasmes négatifs masculins. Ce n'est pas forcément faux, mais son affirmation qu'il n'y a de cyborgs que féminins dans la saga, elle, est fausse, puisqu'on en rencontre notamment un (homme, pilote de navette) dans La maison des Mères. Et j'aurais été curieuse de lire ce qu'elle aurait dit des Honorées Matriarches !
Heureusement, Sam Azulys, dans Géopolitique fractale de l'Imperium, réintègre les Sœurs au sein de l'humanité ! La confrontation de ces deux textes, voisins dans le recueil, est d'ailleurs amusante, tant leurs visions quant au Bene Gesserit s'opposent. Toutefois, l'intérêt de cette intervention repose surtout dans le rappel que fait l'auteur de l'influence de C.G. Jung, et de sa psychologie des profondeurs, sur Frank Herbert, et de la façon dont cette approche a pu colorer le décryptage qu'il faisait des crises mondiales en cours au moment de l'écriture de la saga.
Dans Les futurs contingents : science et prescience dans Dune, Frédéric Ferro décrit les différentes formes de prescience, et la façon dont elles apparaissent dans d'autres œuvres, de la Bible à Fondation, d'Asimov. C'est parfois ardu à lire, mais incontestablement fort érudit.
Si l'analogie entre l'épice et le pétrole, que reprend Christopher L. Robinson dans Dune : un mélange historique, politique et romanesque, me semble ne prendre en compte que le premier tome, j'ai trouvé totalement réjouissante, en plus d'être passionnante, la façon dont l'auteur fait justice de la supposée appartenance de la saga à la fantasy, notamment en montrant combien, au contraire, elle est emblématique de la vocation de la SF à représenter le monde où vit l'auteur.
Cette somme devrait à mon sens figurer dans la bibliothèque de tous les fans de Dune. Même si j'ai été davantage séduite, voire enthousiasmée, par certains textes que par d'autres, j'ai été enchantée d'être replongée de cette façon dans l'univers de Herbert, et bien sûr cela m'a donné envie de relire la saga.
Elle est aussi représentative du sérieux que peuvent apporter des universitaires à l'étude des productions d'un genre encore considéré par certains comme mineur, et de l'intérêt que peut représenter cette étude pour penser certaines problématiques actuelles. Il est sûr que lire dès le premier texte que la température moyenne d'Arrakis est de 20°C, qui est celle que nous promettent les scientifiques pour 2100 si rien n'est fait pour ralentir le réchauffement climatique, fait frémir, et rend la lecture d'une brûlante actualité.
Même si la lecture au format électronique est parfaitement possible, je recommande quand même de choisir la version papier, qui rendra mieux justice aux superbes illustrations de Cédric Bucaille, et facilite un peu le recours aux notes, situées à la suite de chaque texte, et la lecture du CV des différent.e.s auteur.e.s, reporté en fin d'ouvrage, pour qui voudrait en prendre connaissance au moment de la lecture de leur contribution.
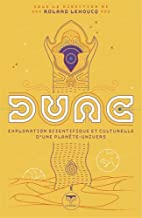
Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.