Anna Quibler dirige la section bio-informatique de la NSF, la Fondation Nationale pour la Science, qui décide des subventions à accorder, ou pas, aux projets qui lui sont présentés. Un jour, en arrivant au bureau, elle remarque que le rez-de-chaussée de l'immeuble abrite à présent l'ambassade du Khembalung, un petit état asiatique dont elle ignorait l'existence. Elle se lie rapidement d'amitié avec ces exilés, et les invite à dîner chez elle. L'ambassadeur, Rudra Cakrin, s'entend spécialement bien avec son second enfant, Joe, un bébé de quelques mois, cependant que Charlie Quibler, le mari d'Anna, promet de mettre les Khembalais en lien avec un lobbyiste qu'il connaît, car ils cherchent de l'aide face aux risques de submersion que court leur île avec la montée du niveau des océans.
Charlie travaille à temps partiel pour Phil Chase, un sénateur démocrate. En fait c'est lui qui, dans l'équipe, est chargé d'élaborer un proposition de loi d'action contre le dérèglement climatique. Comme il n'a pas franchement besoin d'être au bureau pour cela, il peut rester à la maison à s'occuper de Joe.
Le docteur en sociobiologie Frank Vanderwal n'a qu'une hâte : en terminer avec sa mission à la NSF et rentrer chez lui à San Diego, quitter enfin cette cuvette poisseuse de Washington. Il n'a d'ailleurs tissé aucun lien dans la capitale fédérale, même s'il apprécie Anna. Pendant ce temps, à San Diego, Leo Mulhouse et son équipe travaillent pour Torrey Pines Generique, une entreprise que Frank a contribué à fonder. Leur recherche avance plutôt bien, mais ils se retrouvent néanmoins bloqués à un moment donné, et l'achat optimiste par le patron de Torrey Pines d'une entreprise prétendant pouvoir les débloquer s'avère une erreur.
Ce roman est très plaisant. Non seulement on y retrouve les informations scientifiques solides sur lesquelles Robinson base la plupart de ses romans, mais les personnages sont suffisamment individualisés pour être crédibles. L'évolution de celui de Frank, notamment, avec l'impact majeur que va avoir sur lui sa confrontation avec le bouddhisme, par l'intermédiaire des Khembalais, permet à l'auteur de revenir sur une philosophie dont ses lecteurs et lectrices savent qu'il en est familier. Je renvoie ceux et celles qui ne le sauraient pas encore au roman Chroniques des années noires, que Pocket a récemment réédité. L'inversion des rôles parentaux traditionnels, mise en scène par le couple Quibler, était sûrement plus audacieuse quand le roman est paru aux Etats-Unis en 2004, mais reste notable.
Cette date de parution en fait l'un des tout premiers représentants de ce que l'on désigne à présent sous le terme de "climate fiction", à savoir des œuvres de fiction mettant en scène les conséquences du dérèglement climatique. On assiste d'ailleurs dans ce roman à l'une des conséquences en question, avec une inondation de Washington suite à un méga-orage couplé à une forte marée. J'ai trouvé assez désespérant, à la lecture, de m'apercevoir que ce roman âgé de près de vingt ans n'avait pas pris une ride. Certes, le climato-scepticisme est moins répandu, au moins dans les discours, mais le détricotage d'une loi pour la lutte contre le dérèglement climatique pensée comme un tout cohérent rend un son amèrement familier.
L'équilibre entre action et passages plus lents, voire plus théoriques, est vraiment bon, et je me suis rendu compte que ce roman au nombre de pages impressionnant a priori s'avérait de fait un vrai page turner. Si l'écologie vous intéresse, je suis sûre que vous apprécierez de lire cette excellente histoire d'un auteur majeur de la science-fiction actuelle. Ce premier tome d'une trilogie est une histoire complète, et à ce titre peut se lire seul, même si pour ma part je me suis jetée sur la suite dès la dernière page tournée !
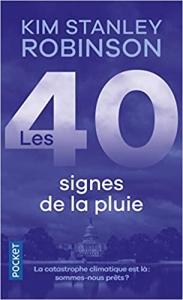
Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.