Lale et Gita sont slovaques et font partie des 58 000 juifs de Slovaquie envoyés dans des camps d’extermination au cours de l’année 1942. Tous deux sont déportés à Auschwitz, dont le fameux « Arbeit macht Frei » est un rappel lugubre et d’une amère ironie sur ce qui se passe dans ce camp et dans d’autres.
Lale est très vite choisi pour être l’assistant du tatoueur du camp, et il est donc chargé d’inscrire directement dans la chair des nouveaux arrivés le numéro qui sera le leur jusqu’à leur mort. Un jour il lève les yeux sur une jeune fille qui arrive et c’est le coup de foudre. Il tombe amoureux de Gita et son but désormais sera de survivre aux horreurs du camp afin de passer sa vie avec elle.
La quatrième de couverture avait tout pour plaire. Un sujet intéressant - l’amour dans les camps de concentration -, une époque compliquée, et un bandeau rouge « Déjà 4 millions de lecteurs » en travers de la couverture (ce qui, habituellement, me fait éviter ce genre de livre). Mais finalement j’ai été très vite agacée par le personnage de Lale, ou pour être exacte par le souvenir que Lale avait de lui-même, retranscris par l’autrice du roman. Car c’est un roman finalement, ce n’est pas une biographie ou un essai, c’est juste un roman qui prend place dans une période très particulière de l’histoire, et Lale n’est pas particulièrement sympathique, même s’il s’emploie, pendant une bonne partie de sa détention, à tenter de troquer des bijoux et des pierres précieuses contre de la nourriture et quelques douceurs qu’il donne à celle qu’il aime et à ceux qui pourraient être en mesure de les aider.
Personne ne nie qu’il y ait eu des histoires d’amour dans les camps, et personne ne nie que certains ont vraiment tout fait pour pouvoir s’en sortir vivants. Mais ce que je retiens de ce récit, en filigrane, c’est l’impression que, quelque part, Lale recherche notre approbation sur ce qu’il a pu faire au nom de l’amour et de la survie. Comme une absolution en quelque sorte. Mais c’est difficile d’adhérer au procédé quand les moments les plus tragiques ou qui ont dû être intenses ne sont pas approfondis, et sont écrit comme des anecdotes communes. Alors oui, beaucoup de récits sur la Shoah présentent des faits horribles avec un certain détachement, et on comprend que c’étaient des choses « habituelles » dans ces camps, mais dans ce récit tout cela sonne de manière très artificielle.
Peut-être est-ce dû à la distance temporelle entre les faits qui s’étalent entre 1942 et 1945, et le témoignage qui a été recueilli après la mort de Gita entre 2003 et 2006, quelque temps avant la mort de Lale. Mais aussi aux douze ans passés entre la confession et la parution du roman. Je ne sais pas, mais même si le roman se lit bien, je n’ai pas accroché au côté artificiel du récit, et surtout au côté « regardez, les nazis pouvaient quand même être gentils ! » même s’ils tiraient sur les prisonniers comme sur des lapins qui ne pouvaient pas s’enfuir.
Ceci est donc un roman pour ceux qui aiment les fins heureuses, nonobstant le contexte.
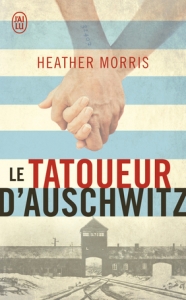
Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.