Andrès et Vian sont frères, fils tous deux du riche Colin Cabayol, mais ils sont très différents : là où Vian, le cadet, vise à entrer dans le moule, et dans le rôle prévu pour lui par leur père, Andrès est rebelle depuis toujours, proche depuis l'enfance des ouvriers du domaine, les Ongles Sales. L'une d'entre eux, Lea Delboscq, porte son enfant, et le jour où il doit choisir, il part en fureur de chez son père. Vian, qui s'est engagé dans l'armée, qui doit rejoindre son poste à l'étranger le lendemain, et qui avait prévu de passer quelques heures avec son frère tant aimé, vivra mal sa défection.
Mais la société où ils vivent est en équilibre instable : la république a certes été proclamée, mais la situation ne satisfait personne. Les nantis et l'Ordre de l'Incréé regrettent le roi, et les plus pauvres estiment que le changement ne va pas assez vite : tout ce qu'ils voient, c'est que d'immenses zones agricoles sont en friche, alors qu'eux n'ont pas un lopin où faire pousser les cultures qui les empêcheraient de mourir de faim.
Le roman suit alternativement les deux frères, avec quelques retours en arrière, vers des épisodes de leur enfance, quand leur mère et leur grand-père étaient encore présents. Le rythme en est plutôt vif, avec quelques moments de calme et d'intimité, pour chacun des deux frères, et l'intérêt ne faiblit jamais.
Cette forme particulière de Science-Fiction qu'est la politique-fiction est relativement peu représentée à l'heure actuelle, et la particularité de Lanero Zamora est de situer son intrigue dans le passé, là où la politique-fiction est plus souvent couplée à l'anticipation, ou à un ailleurs non identifiable. C'est intéressant et habile de la part de l'autrice, car si ce premier tome évoque à l'évidence les six premiers mois de 1936 en Espagne, il ne s'en déroule pas moins dans un univers imaginaire : Panîm n'est pas l'Espagne. Cela dégage donc l'autrice de la fidélité littérale, événementielle, pour lui permettre d'explorer les lignes de force de la situation, et de se concentrer sur ses personnages, souvent emblématiques.
Ainsi, les hommes de la famille Cabayol mettent en relief le thème des rapports père-fils, que Colin (par rapport à Ignacio, son propre père, tyrannique) vit des deux bords, en essayant de contenter tout le monde, ce qui bien sûr le maintient dans un constant porte-à-faux. Ce malaise se reportera sur ses deux fils, qu'il s'agisse d'Andrès tiraillé entre sa caste de naissance et ses goûts de vie, joyeux, populaires et socialement généreux, ou de Vian, porté à être plus représentatif de sa caste que nécessaire pour cacher sa déviance secrète (ou qu'il croit telle). Les femmes de la famille, ou qui gravitent autour d'elle, comme Lea ou Olympia, sont fortes, même si c'est de façon discrète pour les plus âgées, les deux plus jeunes femmes ayant trouvé un moyen de vivre leur propre puissance, chacune à sa façon, sur un terrain de jeux vu a priori comme masculin, qu'il s'agisse de la corrida ou de l'activisme politique.
Parmi les "lignes de force" auxquelles je faisais allusion plus haut, il y a la collusion entre les riches et le clergé, ces deux formations sacralisant la famille, et donc condamnant l'homosexualité de la façon la plus rigoureuse, il y a aussi le terrible slogan "vive la mort !", repris de José Millàn Astray et du franquisme, et plus largement les idéaux des généraux insurgés. Ce que j'ai trouvé très satisfaisant, c'est la façon dont l'autrice montre que la confrontation République / réactionnaires putschistes est portée par des êtres humains, avec leurs qualités, leurs défauts, et leurs aspirations personnelles. Par exemple, on voit des jeunes soldats essayer de déserter au moment de l'annonce de la rébellion par leur général, et des Machinistes agir sans tenir compte des souhaits de leurs camarades majoritaires.
Katia Lanero Zamora dit s'être décidée à écrire cette histoire par son lien familial à l'Espagne du XXe siècle, et il me semble que cela lui donne un rapport particulier à la période qu'elle illustre, tissé d'émotions fortes, mais en même temps distanciées. C'est sans doute ce qui lui permet, ainsi qu'à son lectorat par voie de conséquence, de voir combien les problématiques du temps restent actuelles, avec notamment cette société "à deux vitesses" fondée sur la soumission des pauvres que leurs soi-disant "supérieurs" méprisent. Ceux qui se souviennent des "sans-dents" apprécieront la formule "ongles sales" qui désigne les travailleurs, par exemple.
En somme, un roman bien écrit, passionnant, qui donne à réfléchir, mais que l'on peut aussi, bien sûr, lire comme un roman d'aventures. Pour ma part, j'attends la suite avec une grande impatience.
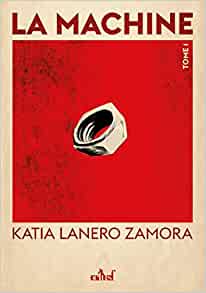
Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.