Cet ouvrage fait suite au colloque organisé au centre culturel international de Cerisy-La-Salle au cours de l’été 2017. Quinze ans auparavant, un précédent colloque avait déjà porté sur l’auteur américain, et certains intervenants de 2017 y avaient déjà participé.
Ce livre réunit donc les vingt-trois essais présentés lors de ce colloque, rangés dans quatre chapitres qui s’adressent à des champs artistiques distincts. Cela va des objets publicitaires à la musique, en passant, évidemment, par le cinéma, les séries télévisés, la BD et autres supports visuels.
Lauric Guillaud : Edgar Allan Poe, personnage de fiction populaire, ou une vie d’outre-tombe
Ce premier essai nous explique comment et surtout combien l’image d’Edgar Poe a été cooptée et représentée très vite après la mort de l’écrivain dans des œuvres de fiction. L’auteur a connu après sa mort plusieurs dizaines de résurrections plus ou moins intéressantes et sa silhouette surgit parfois là où il n’était pas attendu. « on peut voir, dans l’exploitation populaire de Poe un ajout à l’étrangeté déjà présente dans les écrits de l’auteur puisque ces productions présentent toutes bizarrement Poe et un personnage autre que Poe dans le même temps. » (Neimeyer, cité par l’auteur).
Jérôme Dutel : La « chute de la maison Usher » en quelques images ?
Jérôme Dutel se penche sur trois types d’illustrations de la nouvelle de Poe. Tout d’abord en nous parlant de l’illustration de 1894 d'Aubrey Beardsley, puis des différentes déclinaisons en bandes dessinées de Richard Corben où une partie de la genèse de création iconographique et de la réflexion autour de cette création est abordée et enfin il nous parle du court métrage d’animation de Jan Švankmajer qui s’éloigne des deux autres représentations, l’auteur n’étant qu’une voix off dans l’œuvre.
Elodie Chalazon : Po(e)pulaire : le « phénomène Poe » dans la culture 2.0
L’autrice se penche sur le phénomène de la circulation des biens matériels et patrimoniaux associés à Poe ainsi que la circulation des significations associées. D’après elle, il y a une surabondance d’adaptation, de reprises, d’emprunts qui provoque un phénomène qui rend difficile de voir si cela enrichit ou appauvrit l’œuvre. Elle nous parle ensuite de tous les produits dérivés, des batailles de clochers entre Baltimore, Richmond ou New York qui revendiquent tous une partie de l’héritage de Poe. Un point de vue intéressant sur le mercantilisme et ses dérives que provoque le nom de l’écrivain.
Dennis Tredy : « Infidélité » ou « Post-Adaptation » ? Le cycle actuel d’adaptations filmiques et télévisuelles des œuvres d’Edgar Poe
Cette fois-ci, nous plongeons dans les adaptations télévisuelles de l’œuvre de Poe. L’auteur dégage quatre grands cycles d’adaptations de Poe depuis 1908. Entre 1908 et 1915, 1928-1935, les années 60, et le quatrième cycle commencé en 2002. C’est ce dernier cycle qui intéresse particulièrement Dennis Tredy, car il note une explosion des références poesques dans les courts métrages, les longs métrages mais aussi les épisodes de séries télévisées. Il est souligné que la qualité des adaptations est souvent inégale, parcellaire et parfois complètement loufoque, et que cela s’intègre parfaitement au phénomène de « post-adaptation ».
Isabelle Labrouillère : La chute de la maison Usher de Jean Epstein comme laboratoire esthétique : de la mise au tombeau pictural au trouble de l’image filmique
Jusque-là, dans ma lecture de ces essais, je trouvais que les propos étaient clairs et les idées développées intéressantes. Dans cet essai, en moins de trois pages j’étais complètement perdue parmi les mots « Viatique. Linéarité cohésive. Épistème. Jeu des déictiques. Glose. Diégétique. Anamorphose. Herméneutique ». Oui je connais la définition de certains mots, mais j’avoue que ma lecture a été considérablement alourdie et allongée par le fait de devoir sans cesse me référer à un dictionnaire pour être certaine du sens des mots que je lisais. Et je n’ai pas trouvé que l’article apportait quelque chose d'intéressant.
Gilles Menegaldo : Poe au prisme hollywoodien : de D.W. Griffith à Roger Corman
Dans cet essai, Gilles Menelgado s’intéresse aux différentes œuvres de Poe portées au cinéma à différentes périodes. Tout d’abord à l’ère du muet, où des éléments poesques sont combinés à d’autres (intrigue criminelle et sentimentale par exemple), puis dans les années 30 avec trois films décryptés : Black cat, The raven, et Murders in the rue Morgue qui se rapprochent dans leur traitement des films d’horreurs et qui préfigurent des thèmes abordés plus tard dans le cinéma avec des scènes spectaculaires et la réécriture de certaines histoires. Pour terminer, House of Usher (1960) est décortiqué afin de comprendre l’utilisation des différents éléments poesques.
Benoît Tadié : Autour du Chat noir : Poe, Ulmer, Ruric
The Black Cat est un film qui réunit deux grandes figures du cinéma de l’époque : Boris Karloff, célèbre pour avoir incarné la créature de Frankenstein, et Bela Lugosi, qui demeure l’un des plus grand Dracula du cinéma. Les deux s’affrontent jusqu’à la mort dans ce drame qui s’éloigne vraiment de l’œuvre originale de Poe. Benoît Tadié nous offre là une lecture et une analyse du film intéressantes via différents éléments.
Pierre Jailloux : Le business de l’horreur (Le Chat noir, Dario Argento, 1990)
L’auteur, après avoir fait quelques comparaisons et analogies entre Dario Argento et Romero, s’attelle au décryptage du film le Chat noir. Avec l’image du Chat évidemment, mais surtout le traitement photographique amenant à l’horreur via certains plans ou certaines scènes dérangeantes. Pierre Jailloux nous amène ensuite à réfléchir au sujet de la différence entre la surface et le réel.
Florent Christol : « Hop Frog » (1849), fiction matricielle du film d’horreur américain des années 1970-1980 ?
Hop Frog est une nouvelle de Poe qui est peu connue du grand public, mais qui révèle une trame reprise dans les films d’horreur : un personnage principal, brimé par ses pairs, déshumanisé parfois, qui finit par se venger de ses bourreaux de manière particulièrement horrible. Florent Christol développe donc son analyse de plusieurs films qui utilisent cette trame - souvent sans le savoir - (Carrie, Fondu au Noir, Horror High, Halloween), ainsi que d’autres qui en prennent le contre-pied (Les griffes de la nuit). Un point de vue très intéressant sur comment une œuvre peut être réécrite sans en connaître l'origine.
Christophe Chambost : Usher 2000, ou comment adapter « The Fall oh the House of Usher” au XXIe siècle
L’adaptation d’une nouvelle de quatorze pages en un film d’une heure trente / deux heures ne peut se faire qu’en recourant à « l’expansion » , en piochant, par exemple, des références dans d’autres œuvres de Poe. Dans cet article, Christophe Chambot s’attache à expliquer comment quelques cinéastes sont parvenus à nous livrer leur version de la Maison Usher en nous parlant, entre autres, de Usher (2004) et de Crimson Peak, un film de Guillermo del Toro qui date de 2015. Il nous livre une analyse de l’utilisation de certains décors et procédés cinématographiques pour rendre l’atmosphère oppressante et parfois fantomatique qui entoure la Maison Usher.
Joceline Dupont : Variation odontologiques de « Bérénice » à Twixt
Dans cet essai, Joceline Dupont nous livre son analyse de Bérénice, une des premières œuvres d’Edgar Poe, et le met en résonance avec le film Twixt, de Francis Ford Coppola, sorti en 2011. Les deux œuvres ont pour point commun les dents et ont toutes deux une jeune femme en guise de personnage principal. Les dents de Bérénice sont arrachées par son cousin Egæus après qu’il eut profané sa tombe et celles de V. sont tordues et couvertes de bagues. Le film de Coppola fait directement référence à l’œuvre de Poe, étant donné que le cinéaste a littéralement rêvé de l’histoire et Poe apparaissait dans ce rêve.
Henri Justin : Poe dans ses contes : personnage clandestin, présence cryptée
Edgar Allan Poe a créé Arthur Gordon Pym, dont le nom sonne comme celui de l’auteur. Henri Justin cherche l’onomastique dans l’œuvre de Poe, pour nous montrer combien l’écrivain, qui détestait les autobiographies, se cache au sein même des histoires qu’il raconte. Par des jeux de mots subtils et des détails cachés au sein de l’œuvre de Poe, l’auteur de l’article nous emmène donc de Edgar Allan Poe à O, via un chemin tortueux passant par Pym, Prospéro ou encore Pompey. Poe crypte donc sa présence et tel un Petit Poucet, sème des cailloux sur le chemin permettant de le retrouver.
Camille Fort : La verve et le verbe : les contes comiques de Poe et leurs traducteurs
Même si Poe est régulièrement retraduit, c’est souvent la toute première traduction de Baudelaire qui est utilisée au sein des institutions scolaires. Baudelaire ayant négligé les textes humoristiques, leur préférant les Histoires fantastiques, certains traducteurs essaient de traduire au mieux ces textes moins connus, mais parfois plus ardus à décrypter. Il faut en effet soit tenter de restaurer les effets de lecture imaginés par Poe (des onomatopées lors d’un dîner de fou par exemple qui donnent le rythme, les montées en puissance d’un discours) soit renoncer à la fidélité pour travailler sur un principe de ré-énonciation créative.
Une annexe nous permet de comparer les essais de traduction de deux extraits de contes comiques.
Nathalie Solomon : Poe lu par Jules Vernes. A propos de l’article du Musée des familles (avril 1864)
Jules Verne n’aura commis qu’un seul article monographique dans sa carrière littéraire et cet article porta sur l’œuvre de Poe, qui lui donna l’inspiration pour ses propres romans. Nathalie Solomon nous explique que Jules Verne n’utilise que certains passages des histoires de Poe pour donner son avis, et que celui-ci est plutôt superficiel, et qu'il ne tente pas d’approfondir son propos, se contentant d’effleurer le sujet. Et Jules Verne prend soin de parler des récits de Poe où sont évoqués des inventions modernes, surtout les plus techniques qui l'intéressent énormément. Il s’emploie d’ailleurs à relever dans son article ce qui lui semble être les infractions aux lois élémentaires de la physique et à laisser sciemment de côté les aspects qui l’intéressent le moins.
Françoise Sammarcelli : Crises intertextuelles et transpo(e)sitions : Poe et la littérature américaine contemporaine
Poe est partout dans la littérature américaine, y compris dans la littérature jeunesse avec, par exemple, les Désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, mais aussi, plus globalement, dans la littérature policière. La relation intertextuelle avec Poe repose parfois sur la citation ou l’allusion, mais aussi la réécriture ou la transposition au sein même de l’histoire. C’est parfois l’utilisation de thèmes comme la théâtralisation de l’espace, ou la réécriture de conte comme chez Oates qui peuvent évoquer l’écrivain. Françoise Sammarcelli nous livre son analyse à travers quelques exemples qui montrent que Poe est un peu partout dans la littérature contemporaine.
Sophie Mantrant : Envahissante Ligeia « Nor Unto Death Utterly by Edmund Bertrand” (Mark Samuels, 2009)
Mark Samuel est un auteur britannique qui rend hommage à Poe avec ses histoires en forme de pastiche, mais sans établir le « contrat de pastiche » habituellement attendu dans ce genre de récit. Il procède plutôt par touches discrètes en reprenant par exemple la fin d’un poème de Ligeia pour en faire le début d’un autre et commencer ainsi une nouvelle histoire. Sophie Mantrant estime que le texte de Samuel « n’est pas hanté par le spectre de Poe, mais possédé par le maître américain. »
Pénélope Laurent : « Drôles de crimes en Amérique latine »
Horacio Quiroga est un écrivain uruguayen qui est considéré comme le père fondateur du récit court en Amérique Latine. Souvent comparé à Poe pour ses thèmes de prédilection, il a écrit des récits fantastiques ou de terreur qui s’inscrivent dans les mêmes thèmes poesques. Pénélope Laurent développe donc une analyse sur quelques textes de Quiroga, mettant en parallèle les éléments communs aux deux auteurs. Elle fait ensuite la même chose avec Jorge Luis Borges, qui rend hommage à Poe via la parodie et la subversion, puis avec André Caicedo, qui réécrit Poe alors qu’il n’a tout juste que dix-huit ans. Poe demeure donc une référence de lecture, à la fois pour les auteurs, mais aussi pour les personnages des romans qui lisent Poe.
Isabelle Limousin : Edgar Allan Poe, l’art contemporain et son exposition
Dans cet essai, Isabelle Limousin s’intéresse essentiellement aux références explicites à Poe dans l’art des quinze dernières années en donnant des exemples d’expositions un peu partout dans le monde. Elle développe ensuite son propos par l’analyse d’une exposition qui s’est tenue au Musée de Dole en 2004 sur la nouvelle « La lettre volée ». L’enjeu principal du projet étant de proposer une sélection d’œuvres abstraites relevant de l’appropriationnisme (qui est une démarche artistique qui consiste à utiliser une œuvre préexistante). Elle note quelques distorsions dans les références qu’elle relève dans certaines œuvres proposées et les souligne donc.
Maryse Petit : Entrer dans l’esprit : profils de Poe
J’ai trouvé ce chapitre très intéressant, d’une part parce que le sujet des profileurs et des serial-killer m’intéresse, et d’autre part parce que Maryse Petit ne s’est pas contentée de piocher dans la littérature pour étayer ses propos. Elle nous montre que Poe était un précurseur et que son Dupin est le prédécesseur de Sherlock Holmes, lui-même devenu modèle d’autres enquêteurs/profileurs/mentalistes actuels (Dr House, Patrick Jane). Elle appuie ses affirmations grâce à des exemples concrets tirés de la littérature ou des séries policières, mais aussi du témoignage de Micky Pistorius, une profileuse Sud-Africaine, qui prouve que l’esprit d’un enquêteur peut être similaire à celui d’un tueur en série : il faut accepter d’être au bord du gouffre pour approcher les vérités et nul n’est plus près du criminel que le profileur qui le traque.
Guillaume Labrude : Batman : Nevermore : De l’évhérmérisme fonctionnel au retournement d’inspiration
Batman Nevermore est une série de comics où ses auteurs introduisent le personnage de Batman dans l’univers d’Edgar Poe. Dans cette uchronie, l’écrivain va donc vivre des aventures qui vont le pousser à quitter son emploi de journaliste pour se consacrer à son œuvre littéraire. Ce Batman Nevermore ne s’inscrit donc pas dans la chronologie officielle de la licence, il est au dehors et ne trouble donc pas la cohérence spatio-temporelle de l’œuvre. Dans cette série, Batman devient le mentor d’Edgar Poe qui s’emploiera ensuite à transcrire les aventures qu’il aura vécues avec Batman, alors qu’il aurait pu se contenter de raconter l’histoire de Batman. Mais c’est pour mieux rattacher Batman Nevermore à notre réalité.
Christian Chelebourg : Le chat et la souris : Tim Burton ou Edgar Poe dans le Disneyverse
Christian Chelebourg nous livre ici son analyse des relations entre Tim Burton et les studios Disney. De la première collaboration au début des années 80 - Burton avait été embauché pour travailler sur Taram et le Chaudron magique -, jusqu’à Alice au Pays des merveilles, il revient sur les va-et-vient incessants entre les studios et le réalisateur. Montrant au passage que Disney intègre des éléments indirectement poesque dans son disneyverse grâce à Burton, fortement marqué par l’auteur. Peu de références à Poe dans cet article, mais une vision intéressante du développement des relations entre Disney et Burton, ainsi que de leurs apports mutuels.
Chloé Huvet : « Le Masque de la Mort rouge » comme matrice compositionnelle : de la nouvelle d’Edgar A. Poe (1842) au Conte fantastique d’André Caplet (1923)
André Caplet puise dans l’univers de Poe une source d’inspiration remarquable. Après une courte mais riche biographie de Caplet, Chloé Huvet s’empare du sujet du Masque de la Mort rouge et l’analyse de façon approfondie. Puis elle fait la même chose avec le travail de Caplet et ses différentes versions du Conte fantastique, directement inspiré de la nouvelle de Poe. Elle étudie aussi bien le texte utilisé par Caplet que la partition écrite par celui-ci, ainsi que l’utilisation de certains instruments de musique comme la harpe.
Eric Lysøe : C’est triste à faire pleurer les pierres… Debussy et La chute de la maison Usher
Debussy fut un fervent admirateur de Poe, au point de tenter d’écrire plusieurs pièces de musique sur La chute de la maison Usher. Trois tentatives sont répertoriées au fil des ans, mais aucune n’est finalisée. La maladie qui emportera Debussy influe sur son écriture et sur les personnages qu’il intègre dans ses partitions, en particulier les médecins qui sont représentés de manière assez diabolique, au contraire de Madeline, fortement érotisée, et de Roderick, qui succombe aux charmes de Madeline. Plusieurs extraits de partitions et de livret sont inclus afin de souligner et d’expliquer le propos de l’auteur.
---
C’est un ouvrage dense, un véritable travail universitaire collaboratif, et au-delà de l’intérêt individuel des articles, il présente énormément de références dans des domaines parfois très pointus. Je l’ai trouvé très intéressant, même si j’ai dû, régulièrement, chercher des mots que je ne connaissais pas dans le dictionnaire. Heureusement, la plupart des auteurs utilisaient un langage accessible, et seuls de rares articles m’ont semblé un peu indigestes par rapport à l’ensemble.
J’ai pu découvrir toute l’influence, directe ou indirecte, d’Edgar Allan Poe dans énormément de domaines. Parfois sans réelle surprise (cinéma, séries, écrits), parfois avec circonspection (un mug, ou un couple de poupées représentant Poe et sa femme) mais toujours avec une grande curiosité.
Pour tout ceux qui veulent aller plus loin dans l’univers de Poe, je pense que ce livre présente assez de références diverses pour avoir quelques années de lecture ou de visionnage.
A noter la très bonne qualité du livre-objet en lui même. Malgré mes nombreuses manipulations, ma lecture en pointillé, et le fait que les chats le trouvent particulièrement confortable pour faire la sieste (sans doute grâce à la couverture en soft-touch), le livre demeure intègre et la tranche relativement intacte. Un très bon point pour un livre qui n'est pas destiné à être lu en une seule fois.
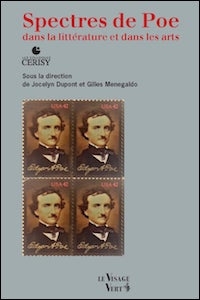
Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.