Nous sommes en 2381 et l'humanité, forte de ses soixante-quinze milliards d'individus, est plus que jamais l'espèce dominante sur Terre. Le problème de la surpopulation a été résolu grâce au système des monades, de gigantesques immeubles de trois kilomètres de haut qui abritent chacun plusieurs centaines de milliers de personnes, le reste de la surface de la planète étant dévolu à l'agriculture pour subvenir aux besoins de cette population démesurée. La cohabitation à l'intérieur des monades n'est pas un problème grâce aux lois et coutumes qui y ont cours. La promiscuité est appréciée, les rapports sexuels aussi banals qu'une simple poignée de mains, et la procréation vivement encouragée. Tout le monde y trouve son compte, des plus bas étages où vivent les ouvriers non qualifiés aux plus hautes sphères peuplées par les grands administrateurs, en passant par les étages des universitaires ou des artistes. Et quant à ceux qui font preuve de pensées déviantes, qui refusent le secours de la religion ou de la médecine, ils sont tout simplement éliminés.
Plutôt qu'un roman, Les monades urbaines est en fait un recueil de nouvelles qui ont d'abord été publiées séparément dans le magazine américain Galaxy entre 1970 et 1971 avant d'être réunies sous la même couverture. Toutes prennent place dans la monade numéro 116 et l'on y retrouve les mêmes personnages, qui occupent chacun leur tour la position de protagoniste avant de la céder à un autre. S'il n'a pas été conçu comme un récit unique, le livre suit néanmoins une certaine progression. La première nouvelle pose bien les bases de l'univers futuriste issu de l'imagination de Robert Silverberg en prenant pour prétexte la visite d'un étranger venu de Vénus, qui partage nos interrogations et notre décalage culturel vis-à-vis des mœurs des habitants des monades. Les textes suivants développent certains aspects de ce système, à travers les yeux d'une jeune fille qui craint d'être déportée avec son mari vers une autre monade fraîchement construite ; d'un musicien populaire qui décide d'expérimenter un nouveau psychotrope ; d'un historien qui, à force de se plonger dans les artéfacts culturels du vingtième siècle, commence à ressentir des sentiments oubliés comme la jalousie ou la rancune. Ce dernier sert de passerelle vers les deux derniers récits qui suivent des individus en pleine crise existentielle, le premier rêvant de découvrir le monde à l'extérieur de la tour et l'autre, ancien enfant prodige, qui recherche désespérément un sens à sa vie.
Il y a des livres intemporels et d'autres qui le sont moins. Les monades urbaines fait clairement partie de la seconde catégorie. Amour libre (complaisamment décrit), drogues psychédéliques (qui ouvrent les portes de la perception), retour à la nature (source d'espoirs déçus), les thèmes majeurs auxquels s'intéresse Silverberg sont emblématiques de la culture hippie des années 60-70. Certains aspects du roman auront ainsi de quoi perturber à l'heure actuelle, en particulier le très jeune âge auquel les habitants des monades commencent à pratiquer des actes sexuels, ou la manière dont les femmes semblent toujours être disponibles pour donner du plaisir aux hommes. C'est assez dommage, mais pas forcément inattendu de la part d'un auteur masculin, qu'un seul texte ait une femme pour protagoniste, et qu'il s'agisse d'une femme faible et soumise.
Néanmoins, cet univers est dépeint de manière crédible et nuancée, avec suffisamment de recul pour que le livre reste lisible aujourd'hui. Les monades ne sont ni une utopie parfaite, ni une terrifiante dystopie. Leur société a ses bons et ses mauvais côtés, elle peut satisfaire le grand public et broyer une poignée d'inadaptés, tout comme la nôtre, et c'est surtout en tant que miroir déformant de notre monde qu'elle est intéressante, et que Les monades urbaines restent dignes d'intérêt, bien davantage que pour leurs nombreux passages érotiques qui en font une lecture réservée à un public averti.
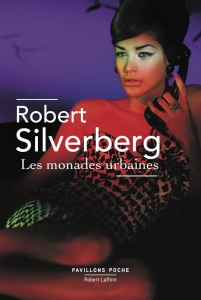
Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.