Alors que le procès historique des attentats du 13 novembre 2015 s’est ouvert au début du mois de septembre 2021, Georges Fenech, ancien juge d’instruction, se propose de revenir sur les circonstances qui ont conduit à ces tueries de masse projetées depuis l’État islamique.
Un sujet que l’auteur, également ancien président de la commission d’enquête parlementaire sur les attentats de Paris, maîtrise puisqu’il avait déjà publié, en 2017, un ouvrage intitulé Bataclan – L’enquête vérité. La pertinence de cette nouvelle publication peut donc d’emblée questionner. Au-delà de son lien étroit avec l’actualité, la perspective ambitieuse d’éclaircir les zones d’ombres restantes sera-t-elle à la hauteur des attentes d’un lecteur averti ? Autrement dit, ce dernier apprendra-t-il de nouvelles informations ? Pour ma part, je me suis plongée dans cette lecture, novice et impatiente de tourner la page, afin de comprendre comment l’impensable a pu être rendu possible.
D’entrée de jeu, la construction du livre est claire. Quatre parties permettent de cheminer depuis les attaques jusqu’au procès. La première plante le décor et revient sur les événements à l’aide de témoignages de survivants et de rapports d’information des équipes d’intervention. Ces documents étant tous issus de comptes rendus d’auditions, peu de place pour le pathos, le ton est surtout froid et sec. La gravité des faits se mesure à travers la liste du déroulé des multiples attaques, et pour chacune d’entre elles, le suivi, heure par heure, de la progression des divers services de force de l’ordre.
La deuxième partie vient dresser le profil des protagonistes par le biais de l’enquête des juges d’instruction après cinq années d’investigation. Celle-ci englobe chaque maillon de la chaîne terroriste, depuis l’aide extérieure jusqu’en haut de la hiérarchie de l’État islamique, en passant par les logisticiens, les auteurs directs et les commanditaires de ces attentats. On apprend que, même si ces derniers étaient extrêmement bien préparés et planifiés, ils auraient pu être identifiés et interpellés. Au lieu de cela, ils ont réussi à échapper à tous les radars, tant français qu’européens.
Car c’est bien de cela dont il s’agit finalement : pointer les problèmes liés à l’existence de guerres de clans (« querelles de clochers ») entre la préfecture de police de Paris, les forces de police et de Gendarmerie nationale, ainsi que la présence interne, à chaque niveau, de services de renseignements qui ne coopèrent pas. Y compris entre les pays. Cette troisième partie, un tantinet prosélyte, aura au moins le mérite d’amener l’auteur à se positionner à travers un message explicite d’une « volonté politique forte ». Elle conduit d’ailleurs directement à mettre en exergue, en dernier plan, les moyens mis en œuvre depuis l’élection présidentielle de 2017 pour « extirper le mal » et mieux lutter contre la radicalisation islamiste. Ou plutôt contre le phénomène d’une « islamisation de la radicalité préexistante » comme le suggère l’auteur.
J’attendais beaucoup de cette dernière partie principalement centrée sur les filières djihadistes, les dangers du séparatisme religieux et le vivier communautariste carcéral. Mais je reste un peu sur ma faim car ce sujet, bien qu'au cœur du débat, est ici à peine effleuré et les analyses, survolées. Même si Georges Fenech opte pour une perspective de désengagement à celle de déradicalisation, j’aurai aimé qu’il développe davantage autour de potentielles préconisations.
En définitive, malgré quelques répétitions et un jargon administratif un peu lourd (vive le glossaire des abréviations en fin de livre et les références en bas de pages), cet ouvrage est un bon complément d’approche du procès prévu pour durer jusqu’en mai 2022. Il n’est cependant pas entièrement suffisant, ni même satisfaisant, si l’on souhaite saisir les enjeux qui se trament au-delà des failles et des dysfonctionnements des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Je demeure mitigée car, derrière ce drame, il y a des humains et j’ai néanmoins l’impression d’avoir lu deux cents pages de dossiers. Il aurait peut-être fallu trouver un volet supplémentaire sur les ressorts psychologiques, pas assez pris en compte alors que l’auteur est pourtant un éminent spécialiste des dérives sectaires. Peut-être l'occasion d'un prochain opus ?
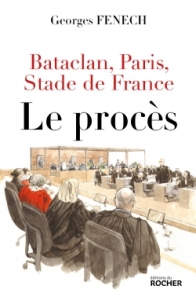
Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.