Théocrite, poète grec né vers 310, est connu pour sa poésie bucolique. Ses idylles pastorales sont ici présentées dans une nouvelle traduction et édition de Pierre Vesperini. Dans son avant-propos, ce dernier explique ses choix de traduction, l’importance accordée au sens et les limites de la traduction du grec ancien au français moderne. Il n’hésite ainsi pas à se démarquer de certains des choix de ses prédécesseurs ou à omettre certains mots. Cet ouvrage contient quinze textes de Théocrite, assortis de notes et, bien sûr, d’une bibliographie des documents utilisés pour la présente édition ou cités en notes.
Dès l’avant-propos, Pierre Vesperini fait part de son admiration pour Théocrite et semble même estimer qu’il n’est pas digne de traduire ce grand poète. Dès lors, il n’est pas moins facile pour le chroniqueur néophyte de donner son avis. L’avis que je vais donc donner ici est celui d’une personne qui ne possède que des connaissances basiques au sujet de l’histoire de la Grèce ou de la poésie et qui n’avait que vaguement entendu parler de Théocrite avant de sélectionner l’ouvrage. Mais qui, heureusement, aime la poésie, l’histoire et la mythologie. Ce préambule me semble important pour que vous puissiez vous -même vous positionner en tant que lecteur potentiel ou non de l’ouvrage. Les quinze textes présentés n’empruntent ni la même forme, ni la même tonalité. Aussi, certains pourront davantage parler au lecteur que d’autres.
Le premier texte, Thyrsis ou le chant, nous emmène à la rencontre d’un berger et d’un chevrier qui conversent près d’un point d’eau. À la demande de son compagnon, Thyrsis, le berger, chante le destin tragique de Daphnis le bouvier. Cette entrée en matière dans l’œuvre de Théocrite m’a décontenancée, à la fois par son rythme et par la construction de ses phrases. Je n’ai pu l’apprécier qu’à ma relecture. Des dialogues entre éleveurs sont aussi présents à d’autres endroits de l’ouvrage. Dans Bergers, Corydon et Battos discutent par exemple en l’absence de leur maître, sur un ton bien différent, quelque peu insolent et qui a mieux fonctionné pour moi. Ce type de texte n’est cependant pas mon préféré.
Les Magiciennes m’a en revanche bien plus intéressé. On y suit plus particulièrement une Magicienne maudissant son amant déserteur. Le poème fonctionne à la fois comme un récit de l’histoire vécue avec cet homme, comme la réalisation d’un sortilège à son encontre et des états d’âme de celle qui le concocte. L’ensemble est percutant et captivant.
Dans Sérénade, un chevrier s’adresse à son amour, devant une grotte. L’identité mystérieuse de la femme aimée, les suppliques languissantes du chevrier et la traduction très moderne de Pierre Vesperini m’ont également permis d’apprécier ce texte.
La fête des moissons à Cos évoque davantage le récit d’un voyage ou plutôt d’une rencontre particulière sur la route de Cos. Pour un peu, on aurait presque l’impression de lire l’un de ces récits fantastiques du XIXe, où le merveilleux surgit à l’improviste dans le quotidien d’un narrateur nous contant par la suite ses déboires au coin du feu. Les adoratrices d’Adonis ou les Syracusaines flirtent davantage avec l’humour, en dépeignant deux femmes mariées ne mâchant pas leurs mots.
Certains textes, comme Le Cyclope ou Hylas, font plus explicitement référence à des éléments mythologiques et rendent donc davantage nécessaire une connaissance du sujet, malgré les notes de fin. D’autres textes encore, comme l’Insuffleur (l’amant), sont plus fortement empreints de poésie.
En résumé, il y en a pour tous les goûts à condition d’avoir un minimum de curiosité et d’appétence pour les poésies ou les mythes. La traduction rend la lecture elle-même très accessible à un public moderne, comme en témoigne par exemple les paroles « c’est mon mari qui déraille », mises dans la bouche d’une Syracusaine.
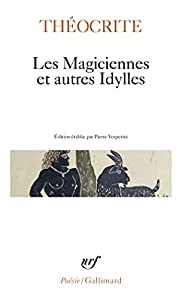
Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.