Encabanée est le premier tome d’un triptyque écoféministe qui se poursuit avec Sauvagines (finaliste des prix France-Québec 2020 et Jovette-Bernier 2020, paru aux éditions Stock en 2022) et Bivouac (publié pour l’instant uniquement chez l’éditeur québécois XYZ).
Sous forme de journal de bord, ce court roman à la fois âpre et poétique raconte la dizaine de jours que l’autrice, Gabrielle Filteau-Chiba, a passé dans un refuge du Bas-Saint-Laurent, dans l’Est du Québec. Sous les traits d’Anouk, son personnage principal, elle nous livre un récit intime et poignant, entremêlant avec justesse son retour d’expérience et une part de fiction narrative.
Lassée par un quotidien dépourvu de sens, Anouk a décidé de quitter Montréal et le confort de son appartement pour se réfugier dans une cabane abandonnée au fond des bois. Loin de toute civilisation, elle se retrouve seule en plein milieu de l’hiver, face à elle-même et à l’écho de ses pensées. Armée d’un crayon, elle entreprend de les canaliser avec des illustrations et des listes de souhaits, de gratitudes et de questionnements, parfois désœuvrées, mais le plus souvent malicieusement ironiques et réconfortantes.
C’est comme ça qu’on découvre avec humour et émotions comment la jeune femme, déterminée et passionnée, tente de survivre par -40° dans cette région reculée du Kamouraska. Parce que vouloir retrouver le sentiment d’enracinement en travaillant le sol et en effectuant de longues marches en forêt, c’est une noble quête, mais qu’il lui faut en premier lieu impérativement lutter contre le froid pour ne pas tout bêtement mourir gelée.
Ainsi, dès l’aube, on se lève avec elle. On rallume le poêle presque éteint. On s’imagine pelleter le sentier. S’acharner à couper et à rentrer du bois. Remplir les chaudières d’eau de rivière. Les placer à côté du poêle pour qu’elles ne gèlent pas. Pelleter à nouveau de la neige le long des murs de la cabane pour créer une bulle. Bourrer le poêle de bûches. Remplir la lampe à huile et attendre que la nuit s’engouffre. Une longue nuit sujette aux divagations et aux confessions pour ne pas laisser de place aux vieilles peurs. Ni à la bande de coyotes qui encerclent le refuge et hurlent à l’unisson, « leurs yeux d’affamés » vacillant comme « les lampions d’un cimetière ».
On se surprend à retenir son souffle. A veiller sur les flammes, en proie à certaines crises d’insomnie délirantes. A tendre l’oreille pour écouter la chorale des animaux sauvages et les bruissements des arbres. Espérer voir les premières lueurs d’une nouvelle journée : le moral étant l’une des choses primordiales à ne pas perdre dans cet environnement où règne la loi du plus fort.
Alors certes, on n’en saura pas davantage sur les motivations de cet exode, mais les références aux ouvrages de ces compatriotes québécois (Pierre Falardeau, Louis Hamelin et surtout Anne Hébert) semblent être les compagnons de route nécessaires pour se laisser entraîner hors des sentiers battus. Pas de craintes à avoir concernant les mots récalcitrants qui demeurent étrangers à notre oreille grâce au petit lexique d’argot québécois en fin de pages.
La lecture terminée, demeure le souvenir d’un bon moment. C’est une histoire qui se savoure par morceaux afin d’en préserver, si ce n’est le goût, au moins l’intérêt de ne pas l’épuiser trop vite. J’ai aimé partager les réflexions d’Anouk, oscillant entre profondes revendications écologistes et féministes, et moments de paniques totales, d’incertitudes et de manques.
Dommage toutefois que soit venu se greffer in fine une pseudo romance furtive avec un criminel activiste et fugitif… Trop de contrastes avec la soif de liberté à laquelle j’aspirais personnellement. Celle que seuls les romans de nature writing comme ceux de Thoreau ou de Tesson (que l’on croit retrouver parfois en filigrane, notamment à travers la compagnie d’une bouteille de gin) arrivent à sublimer.
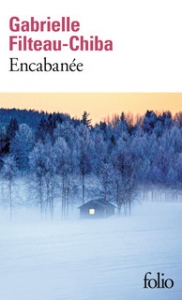
Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.