Les petits hommes de la pinède a reçu le prix Maurice-Renard de la Société des gens de lettres en 1930.
Le docteur Moranne vient de mourir dans l'asile d'aliénés où il croupissait depuis des années. Son internement avait été la conclusion d'une affaire sordide : il était accusé d'avoir volontairement mis le feu à la propriété de son collègue, le docteur Dofre. L'incendie avait ravagé le manoir et la pinède voisine, seul Moranne y avait survécu, bafouillant des propos incohérents à propos de petits hommes. Il laisse cependant derrière lui un étrange manuscrit dans lequel il explique les raisons de son geste. Il y décrit comment Dofre l'a invité à le rejoindre pour constater le résultat de ses terribles recherches : la création d'un peuple d'humains de taille réduite. Vivant de manière primitive dans la pinède, ils vouent un culte à Dofre, qui leur a interdit d'en franchir jamais le mur d'enceinte. En s'immisçant dans cette étrange expérimentation, Moranne va malgré lui bouleverser ce fragile équilibre et précipiter la catastrophe.
Ce court roman de l'écrivain français Octave Béliard (1876-1951) paraît d'abord en feuilleton dans les pages de la revue L'Association médicale entre 1927 et 1928. Il connaît une première édition en livre en 1929, mais dépouillé de son prologue et de son épilogue qui forment le récit-cadre de l'histoire du docteur Moranne. Les éditions GandahaR nous proposent ici une version intégrale du texte, avec en bonus une nouvelle du même auteur, Aventures d'un voyageur qui explora le temps, parue pour la première fois quant à elle en 1909.
Avec son savant fou qui engendre une race de créatures étranges qui finiront par causer sa perte, Les petits hommes de la pinède rappelle irrésistiblement L'île du docteur Moreau de H.G. Wells, sorti en 1896. Ces deux livres partagent des axes de réflexion similaires, comme le rôle joué par l'être humain dans la nature et ses limites, la tentation de jouer à Dieu ou la nature des normes qui permettent la vie en société. À travers ses personnages, Octave Béliard propose des débats philosophiques sur ces questions et d'autres qui se laissent lire. Ils ont en tout cas bien moins mal vieilli que les théories « scientifiques » sur le nanisme développées par les docteurs Dofre et Moranne (d'ailleurs, Moranne, Moreau : coïncidence ?), dont l'inanité est aujourd'hui patente. La manière dont le texte n'arrête pas de parler de « Nains » est assez désagréable dans la mesure où ce terme est souvent perçu comme péjoratif de nos jours, surtout avec la majuscule qui semble impliquer que ces personnes constituent une race distincte du reste de l'humanité.
L'intrigue passe par toutes les étapes attendues dans une histoire de ce genre. On découvre avec le protagoniste les expériences du docteur Dofre, la société qu'ont réussi à édifier les petits hommes du titre, et le rôle involontaire que va jouer Moranne. Certains passages sont particulièrement amusants, comme celui où Moranne allume sa pipe alors qu'il est penché au-dessus d'un temple, donnant à croire aux habitants de la pinède qu'un nouveau dieu cracheur de feu a fait irruption dans leur monde : c'est digne d'un Jonathan Swift envoyant son Gulliver chez les Lilliputiens. En revanche, d'autres fils narratifs étaient peut-être dispensables, comme l'histoire d'amour assez mal amenée entre Moranne et une représentante du petit peuple (la seule femme avec un rôle un tant soit peu développé, d'ailleurs).
Les descriptions de la société des petits hommes sont particulièrement intéressantes et c'est là que l'imagination d'Octave Béliard s'en donne le plus à cœur joie. En partant des contraintes de l'environnement où ils sont placés, il conçoit un peuple de chasseurs et de cultivateurs à la fibre religieuse développée, dont l'économie et l'artisanat tournent en grande partie autour du pin et de ses produits (la résine, les pignes). Par moments, j'avais presque l'impression de lire un compte-rendu d'une partie de jeu vidéo de simulation divine comme Black & White !
En bref, Les petits hommes de la pinède n'est pas un mauvais roman, mais c'est tout de même une lecture dont l'intérêt est d'ordre historique avant tout. Il en va de même pour la nouvelle bonus, Aventures d'un voyageur qui explora le temps, une histoire de voyage temporel compétente mais dont la chute sera prévisible pour quiconque a déjà lu le moindre récit de ce type (et qui avoue d'ailleurs elle-même sa dette envers Wells). C'est tout de même une belle occasion de découvrir un écrivain oublié qui a fait partie des pionniers de la science-fiction française (ou « merveilleux-fantastique », comme on disait à l'époque).
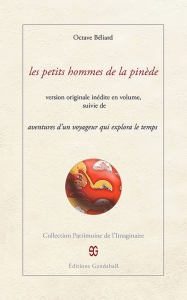
Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.