Évoquer l’histoire de l’hébreu, c’est raconter la renaissance d’une langue écrite, fait unique à ce jour en linguistique. Réputée langue morte depuis plus de deux mille ans, l’hébreu est aujourd’hui largement parlé en Israël. Pour tenter de saisir l’origine de cette langue, l’historienne Mireille Hadas-Lebel nous plonge trois millénaires avant notre ère, une période marquée par deux systèmes d’écriture aux origines pictographiques - des représentations symboliques imagées - qui préfigureront l’apparition d’une écriture pré-alphabétique. D’une part, les hiéroglyphes égyptiens qui prirent progressivement une valeur syllabique ; d’autre part, l’écriture cunéiforme adaptée du système sumérien par les Assyro-babyloniens.
Dans la tradition juive, l’écriture est considérée comme une invention divine et son apparition correspond aux Dix Commandements gravés sur des tables de pierre. Quant aux historiens, ils déterminent vers -700 la première inscription retrouvée en hébreu et au -XIVe siècle l’apparition d’abécédaires contenant trente signes cunéiformes parmi lesquels vingt-deux signes correspondent aux lettres de l’alphabet hébreu.
Comment la langue hébraïque est-elle parvenue jusqu’à nous ? D’abord et surtout parce qu’elle est la langue dans laquelle nous a été transmis l’Ancien testament, par opposition au Nouveau testament écrit en latin. L’hébreu était parlé pendant huit siècles jusqu’à l’an 200 malgré des obstacles d’ordres politico-religieux, avant de n’exister qu’à travers la littérature. Jusqu’à cette période, la langue écrite ne comportait pas de voyelles et n’était pas régie par la grammaire qui ne commencera à s’imposer réellement qu’au Moyen-Âge.
Aux IXe et Xe siècles, l’hébreu fut largement concurrencé par l’arabe car les musulmans, soucieux de consolider leur doctrine, ont traduit de nombreux ouvrages scientifiques et philosophiques grecs, ce qui leur assura un prestige intellectuel international. L’arabe était par ailleurs considéré comme parent de l’hébreu. Partout où les juifs étaient présents, ils développèrent leurs propres langues avec des particularismes géographiques : le judéo-arabe, le judéo-grec, le judéo-espagnol ou le judéo-italien. Quant au judéo-allemand, aussi appelé yiddish, il constituait la langue maternelle de onze millions de juifs à la veille de la Seconde guerre mondiale.
C’est sous l’impulsion timide du premier Comité de la langue hébraïque créé en 1890 que la langue parlée put renaître. Alors que la littérature hébraïque connut un véritable essor dans la première moitié du XXe siècle, le Comité fut relayé en 1954 par l’Académie du nouvel État d’Israël, mandatée par le Parlement israélien, pour procéder à l’étude de la structure de la langue et son histoire. L’Académie était également chargée d’encadrer son évolution en réglementant la grammaire, l’orthographe et l’entrée de néologismes. Le vocabulaire s’est ainsi considérablement enrichi, et pour partie, grâce aux emprunts aux langues européennes, et ce, malgré l’opposition des ultra-orthodoxes souhaitant préserver une langue sacrée.
Parlé par 34 000 locuteurs en 1918, l’hébreu en comptabilise aujourd’hui six millions. C’est cette aventure que raconte Mireille Hadas-Lebel avec toute la rigueur historique requise pour l’étude de cette langue de la Bible. Si le livre est globalement accessible, quelques notions de linguistique pourront néanmoins se révéler utiles pour apprécier pleinement les propos de l’auteure.
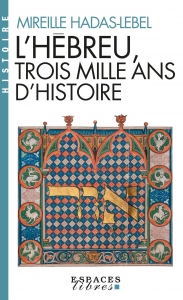
Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.