Si les psychanalystes s’accordent sur l’idée que le rêve est la voie royale qui mène à l’inconscient, L’analyse des rêves représente sans doute une porte d’entrée idéale à la méthode jungienne. Loin d’être un livre purement théorique pour les initiés, il s’adresse à un public large dans un style oral très didactique. Il s’agit, en effet, de la retranscription d’un séminaire dont est extraite une série de conférences que Jung consacra au rêve entre 1928 et 1930. Ici, il délaisse le ton professoral pour inviter les auditeurs à échanger et débattre avec lui.
A l'évidence, cet ancien disciple de Freud se détache assez vite de sa pensée quant à l’approche analytique des rêves. Dès sa troisième conférence, il s’oppose ouvertement au fondateur de la psychanalyse à qui il reproche de se baser sur une théorie construite par ses patients. A ses yeux, point de déguisement dont "l’inconscient n’a que faire. C’est nous qui déguisons". "Le corps ne ment jamais", assurait la psychanalyste Alice Miller ; "les rêves ne trichent jamais", affirme Jung.
Autre point de divergence, Jung s’appuie en partie sur d’autres sciences humaines telles que l’anthropologie et l’ethnologie et se réfère aux symboles mythologiques ou aux rites religieux auxquels il compare les rêves de ses patients pour en tirer une signification aux dimensions multiples. Cette approche, que l’on qualifierait aujourd’hui d’intégrative, lui permet de relier les rêves de ses contemporains à des motifs symboliques plus anciens et, en définitive, de dessiner ce qu’il définit comme un inconscient collectif.
En évoquant d’autres faits survenus ailleurs pendant ses conférences, il met également en lumière son concept de synchronicité, là ou d’autres n’y verraient que simples coïncidences. "Il s’agit seulement d’une sorte de régularité irrationnelle. Les cultures orientales fondent l’essentiel de leur science sur cette régularité, et considèrent les coïncidences comme une base plus solide pour le monde que la causalité. Le synchronisme caractérise le préjugé de l’Est. La causalité est le préjugé moderne de l’Ouest".
Si la grande érudition de Jung dans de nombreux domaines pourrait rebuter plus d’un lecteur, elle se déploie dans ce texte de manière si limpide qu’il reste aisé de saisir sa pensée pourtant complexe. Et c’est le plus grand atout de ce livre.
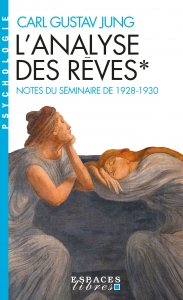
Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.