Les faits, rien que les faits ? Dans son avant-propos, c’est au personnage emblématique de son œuvre, Nathan Zuckerman, que s’adresse Philip Roth pour éclairer la manière dont il a envisagé d’écrire, en 1988, son autobiographie. S’il prend un plaisir manifeste à brouiller les pistes, il s’enferre dans un raisonnement circulaire sur la question de l’interpénétration du réel et de la fiction. Mais en s’adressant dès l’ouverture du livre à un personnage fictif, et non au lecteur, le romancier donne d’ores et déjà la clé de lecture d’un titre qui s’apparente alors à une affirmation fallacieuse sinon ambiguë. Dès lors, ce jeu de dupes ne trompe personne : un récit ne peut être purement factuel et la représentation du réel, si proche soit-elle du réel, n’est jamais le réel.
Faisant suite à cet avertissement ironique, l’auteur nous raconte son enfance dans les années 1930, dont l’épicentre est un terrain de base-ball de la banlieue new-yorkaise. Devenu le point de ralliement de sa bande de copains, ce terrain de jeu est aussi l’espace mental où se construit un sentiment d’appartenance à la fois communautaire et national. De fait, petit-fils d’immigrants juifs autrichiens installés aux États-Unis à la fin du XIXe siècle, il vit avec ses parents et son frère aîné dans un quartier juif de la middle-class de Newark.
En évoquant cinq événements de sa vie, sur quatre décennies, l’auteur explore l’élaboration de son identité culturelle – américanité et judéité –, ses rapports à la famille, à la communauté juive, aux femmes et à l’écriture. Dans cette frise chronologique, il précise comment il est devenu écrivain en s’affranchissant de ses coéquipiers de base-ball, de sa fraternité universitaire, de sa famille puis de son mariage pour finalement remporter, en 1969, le prix Pulitzer pour son ouvrage Portnoy et son complexe.
Si la narration est fluide, l’autodérision et l’ironie jamais loin, et la lecture plaisante, ce texte nous laisse toutefois la pénible sensation de se répéter tout en restant à la surface des choses. Et puis vient le prologue. Et là, on assiste à un basculement où, sans rien s’épargner, l’écrivain nord-américain se livre à un minutieux exercice de dynamitage de son texte dont on ne sait si c’est la lucidité, le sarcasme ou le masochisme qui l’emporte. Ce point de rupture narratif, véritable coup d'éclat qui redonne du relief à l’entreprise autobiographique, ne parvient pas pour autant à nous faire oublier ce sentiment maintes fois éprouvé : le verbiage et les vaines circonvolutions de l’écrivain lassent.
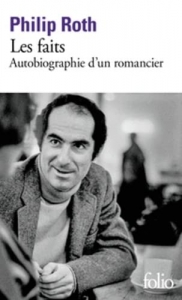
Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.