Étudiée et disséquée par nombre de chercheurs et de psychanalystes, la Lettre au père est désormais considérée comme un éclairage majeur sur l’ensemble de l’œuvre et sur la personnalité de Franz Kafka. Elle n’a pourtant jamais été remise à son destinataire, mais seulement à sa mère. Malgré les dernières volontés transmises à son ami, le poète Max Brod, les manuscrits n’ont pas connu le destin funeste que l’auteur leur vouait, exception faite de certains documents volés par le régime nazi et bel et bien perdus. Contre vents et marées, cette longue lettre est finalement publiée en 1952, bien après sa mort.
Ce manuscrit relate la relation ambivalente que Kafka entretient depuis son plus jeune âge avec son père, Hermann. Figure toute-puissante et autoritariste, admirée autant que détestée, ce père au physique imposant apparaît tel un géant inaccessible face au "petit squelette flageolant" de son fils. S’exprimant avec une voix tonitruante et par des sentences définitives, tout n’est pour lui que prétexte à remontrances, humiliations ou ironie cinglante qui ne rencontrent le plus souvent que le silence mutique de Franz, sorte d'enfant terrassé par le dragon.
Devenu l’aîné de la fratrie par de malheureuses circonstances – ses deux frères aînés sont morts jeunes –, il subit le premier l’ire et le caractère obtus de son père : "il ne t’est a priori pas possible de parler calmement d’une chose avec laquelle tu n’es pas d’accord ou qui simplement ne vient pas de toi". Son opposition systématique perpétue le sentiment d’incommunicabilité filiale. La loi du père, qu’il ne s’appliquait pas à lui-même, demeure incompréhensible au fils tandis que les sentiments de honte et de culpabilité découlant de l’incapacité à répondre aux attentes paternelles prédominent.
Cette relation profondément dissymétrique dont Kafka ne parvient pas à s’extraire façonne le rapport au monde de l’écrivain : paranoïaque, inintelligible, annihilant l’individu, absurde et froidement ironique. Tous ces éléments structurent les univers kafkaïens tels que La colonie pénitentiaire ou Le procès au sein duquel le protagoniste déambule dans des espaces labyrinthiques oppressants, jusqu’à être victime d’un châtiment sans jamais être informé des motifs de son accusation. Ici, c’est le procès du père, "l’instance suprême", qui est fait, parfois avec auto-complaisance mais toujours avec acuité et dans une langue aussi précise que lucide et fantasmatique. "Dans mes livres, il s'agissait de toi, je ne faisais que m'y plaindre de ce dont je ne pouvais me plaindre sur ta poitrine".
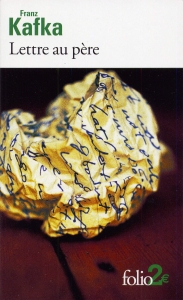
Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.