Leo Kall est chimiste. Marié, trois enfants, il est parfaitement inséré dans la société de la Ville de Chimie no 4 et ses travaux de recherche viennent de connaître leur aboutissement. En effet, il est parvenu à développer une drogue, la kallocaïne, qui agit comme un sérum de vérité infaillible lorsqu'elle est injectée à quelqu'un. Sous son influence, impossible de taire ses secrets les plus inavouables, ses désirs les plus profonds.
La découverte de Leo constitue une aubaine pour l'État mondial. Ses dirigeants comptent bien l'exploiter pour accroître encore davantage le contrôle qu'exerce leur gouvernement totalitaire sur les moindres détails de la vie de chacun. Leo devrait être aux anges d'avoir ainsi contribué à renforcer le pouvoir de l'État, et pourtant, le doute le ronge. Sa femme veut-elle vraiment le tromper avec son supérieur ? Le contrôle total des individus par la société, jusque dans l'intimité de leur esprit, serait-il réellement une bonne chose ?
Quand on pense aux grandes dystopies du vingtième siècle, quelques titres viennent immédiatement à l'esprit, comme 1984 de George Orwell ou Le Meilleur des mondes d'Aldous Huxley. À moins d'être particulièrement versé dans le genre, ce ne sera pas le cas de Kallocaïne, de Karin Boye. Plusieurs raisons expliquent sans doute le relatif oubli dans lequel est tombé ce roman, comme le fait qu'il ait été écrit par une femme, que celle-ci se soit donné la mort l'année suivant sa parution, ou bien qu'il provienne de Suède, pays dont la littérature ne s'exporte pas aussi bien que celle de langue anglaise. En tout cas, ce n'est sûrement pas une question de qualité, car c'est un texte absolument fascinant.
L'État mondial imaginé par Karin Boye, inspiré par l'Allemagne nazie et l'Union soviétique des années 1930, est un endroit singulièrement déplaisant dans lequel l'individu est entièrement subordonné à la volonté de l'État. De la naissance à la mort, on ne vit que pour le servir, d'une manière ou d'une autre, et il est impossible de s'en extraire de quelque façon que ce soit. Un redoutable dispositif de surveillance permet aux forces de police de surveiller tout le monde et d'agir au moindre signe d'anticonformisme. Comme de bien entendu, cette rigueur n'est valable que pour les bas échelons de la société, les élites pouvant se permettre leur lot d'entorses à la loi commune sans avoir à craindre de répercussions. Pour les Européens de 1940, une telle description évoquait au mieux ce qui risquait fort de leur arriver dans les années à venir, et au pire ce qui était précisément en train de leur arriver.
On découvre ce monde cauchemardesque à travers les yeux de Leo Kall, un individu qui, comme le Winston Smith d'Orwell ou le John de Huxley, se découvre progressivement incapable d'y vivre sans se révolter. Comme eux, c'est un homme loin d'être parfait et on pourrait même le décrire comme franchement névrosé. Pourtant, il est aisé de ressentir de l'empathie pour lui, car ce n'est pas une faiblesse de caractère qui l'amène à commettre des actes que l'on jugerait odieux, mais bien la société démente dans laquelle il évolue et qui l'a façonné malgré lui. Ses relations avec son entourage sont finement décrites, en particulier l'amour-haine qu'il entretient avec sa femme Linda et la jalousie mêlée d'admiration qu'il éprouve pour son supérieur Rissen. Ce sont ces relations et leur évolution qui font progresser le récit, davantage qu'une intrigue dans laquelle il ne se passe au fond pas grand-chose et dont on devine dès le début qu'elle ne finira pas bien.
Kallocaïne est une dystopie qui n'a rien à envier aux grands noms du genre. Espérons que cette réédition lui permettra de rencontrer le public qu'elle mérite, car le tableau qu'elle dresse d'un État policier totalitaire reste toujours glaçant de pertinence, voire de réalisme, en ce début de vingt-et-unième siècle.
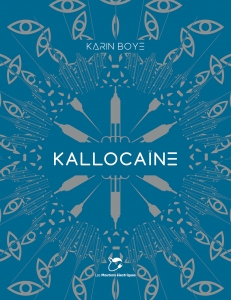
Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.