François Jullien part de la question posée par Blaise Pascal de ce qui est le "moins croyable : Moïse ou la Chine ?". Il étudie la façon dont la pensée de Dieu, en tant qu'Etre suprême, a influencé non seulement la civilisation par l'intermédiaire des deux monothéïsmes les plus anciens encore actifs, mais aussi la philosophie. En effet, cette idée est corrélée à l'importance de la Parole en Occident, laquelle est à la base de la philosophie telle que nous la connaissons.
Afin de mettre en lumière des bases si bien ancrées qu'elles risqueraient d'être littéralement im-pensables, il montre, par l'exemple de la Chine, qu'elles ne sont pas si fondamentales que cela, puisqu'il existe toute une civilisation, aussi riche qu'ancienne, qui s'en est parfaitement passée. Ce n'est pas que l'idée d'un Tout-Puissant unique ne soit jamais venue aux habitants de la Chine ancienne, c'est qu'elle a évolué sans heurt majeur vers la vénération des ancêtres, et de la figure tutélaire du bon souverain comme Fils du Ciel. Les normes sociétales, et le nécessaire respect à leur porter pour créer et maintenir une civilisation, ont remplacé "sans parole" une morale fondée sur des lois religieuses.
Cette absence de Parole fondatrice, de mythe, dans la civilisation chinoise, au moins jusqu'à l'importation du Bouddhisme, tient pour une part à ce qu'il n'y existe pas de figure du Mal opposé au souverain Bien. Bien évidemment, les catastrophes et accidents néfastes de la vie y sont connus, mais le "mal" est vu comme une rupture de rythme, un défaut de régulation ou un témoin de décadence, issus de l'imperfection humaine originaire, et qu'il appartient à chaque homme de rectifier dans sa propre conduite.
Quand ne se déploie pas l'idée de Dieu - sous-titre de cet essai -, aucune guerre de religion n'est possible. Que Dieu soit mort ou pas, qu'on y croie ou pas, n'a pas vraiment d'importance. La foi et l'athéisme, inséparables en Occident, sont renvoyés dos à dos comme une monnaie sans valeur.
On peut éprouver une sorte de vertige, à la lecture de cet ouvrage, car il permet de mesurer combien notre pensée est façonnée, qu'on le veuille, et même qu'on le sache, ou non, par les siècles de civilisation qui nous ont précédés ; combien les idées de progrès, de raison, de science, se sont construites en regard de la religion, qu'il s'agisse d'en prouver la véracité ou la fausseté ; combien nous en restons marqués. L'écriture n'est pas d'un abord facile, même si la construction rigoureuse, par sa progression temporelle, et grâce à la séparation des thèmes en chapitres, est d'une grande aide. Il n'en reste pas moins que c'est un essai qui sera plus facilement lu par les lecteurs ayant des notions de philosophie, ou bien sûr de théologie.
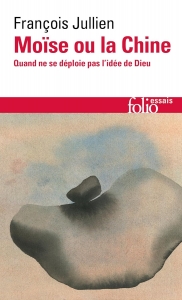
Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.