Prix Kourouma 2023
Prix Livres en Boîte 2023
Après une brillante carrière dans la fonction publique qui s'est mal terminée, Ramata a choisi de se reconvertir dans l'art-thérapie. Elle a trouvé un stage dans un EHPAD auprès de résidents atteints d'Alzheimer. A travers ses ateliers, elle espère dénouer leur parole et atteindre leurs souvenirs. Une patiente attire son attention plus que les autres. Il s'agit de Mme Astrida, la seule métisse de l'établissement. Depuis que la maladie a atteint un nouveau palier, Mme Astrida s'enferme dans une langue que personne n'a su identifier et s'éloigne de plus en plus du français. L'EHPAD ne connaît pas précisément le passé de Mme Astrida et ne sait pas comment lui venir en aide ; sans parler d'une volonté toute relative de lui venir en aide. Ramata va trouver en la psychologue Claude une alliée précieuse pour remonter dans le passé de Mme Astrida.
Pour Ramata, il s'agit aussi d'une remise en question de son vécu. Arrivée enfant du Sénégal, elle a vu son père cumuler deux boulots, essayer de donner une vie normale et meilleure que la sienne à ses enfants. Grâce à ses efforts pour rentrer dans le moule français, Ramata et ses sœurs et frère ont pu faire des études et mener une carrière. La famille a plus ou moins rompu les liens avec le Sénégal et Ramata arrive à un stade de sa vie où elle se pose des questions sur sur identité. Le lien qu'elle va créer avec Mme Astrida va l'aider à trouver son propre chemin.
En toile de fond de cette histoire contemporaine, il y a le passé de Mme Astrida, née Consolée. Le lecteur assiste aux efforts de Ramata et de Claude en sachant la vérité. Le roman nous éclaire ainsi sur un fait historique de la colonisation : l'arrivée de colons blancs de toutes nationalités au Ruanda-Urundi pour exploiter les ressources du pays. Ces colons venus seuls, sans femmes, ont trouvé sur place de quoi étancher leur soif de tendresse et de sexe. De là sont nés des enfants métis, qu'on a arrachés à leurs mères pour les européaniser à l'image de leurs géniteurs.
Au-delà de la dimension historique du passé colonial belge et de ses conséquences, Beata Umubyeyi Mairesse aborde également le problème naissant et qui va prendre de l'ampleur des immigrés atteints d'Alzheimer qui retournent à leur langue maternelle et oublient le français. Comment allons-nous prendre en charge le problème, alors que le personnel soignant en EHPAD se fait de plus en plus rare ?
Grâce à son écriture toujours aussi belle, précise et poétique, Beata Umubyeyi Mairesse partage avec nous des destins de femmes fortes, qui ont su se construire sur des fondations branlantes. Elle éclaire un fait historique que nous Français ne connaissons pas de la même façon, la vision économique simple de la colonisation belge sans volonté de peuplement, et le déplacement de milliers d'enfants ni noirs ni blancs. Des enfants tels que beaucoup d'autres, arrivés dans un pays étranger avec leur langue, dans laquelle ils se réfugient au crépuscule de leur vie. L'autrice nous sensibilise à cette problématique avec talent et émotion.
Si vous aimez les romans qui abordent le thème de l'identité, des origines, de la transmission dans les familles dispersées et pluriculturelles, ne passez pas à côté de Beata Umubyeyi Mairesse.
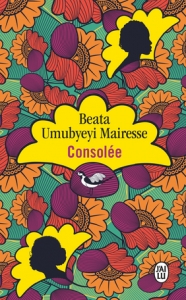
Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.