En 600 après Ford, les humains ne se reproduisent plus entre eux — même s’ils copulent joyeusement dès leur plus jeune âge — et les bébés sont créés dans des bocaux et sur ce qui s’apparente à des chaînes de montage, où ils reçoivent tout ce dont ils ont besoin pour se développer. Placé dès leur naissance dans des pouponnières, ils grandissent ensuite sous la férule d’infirmières qui prennent soin d’eux, et surtout qui leur inculquent les préceptes qui feront d’eux des êtres humains heureux en fonction de leur caste. Le soma joue aussi un grand rôle dans ce bonheur, car cette drogue légale est obligatoire pour tous et chacun est encouragé à l’utiliser.
Il reste cependant de rares réserves dans le monde, où vivent des « sauvages », à l’ancienne. Ils sont monogames et donnent eux-même naissance à leurs enfants, ce qui est considéré par le reste du monde comme une immonde obscénité.
C’est lors d’une visite touristique dans une de ces réserves que Bernard Marx, un Alpha Plus contrefait (on murmure dans son dos que de l’alcool aurait été injecté par erreur dans son sang quand il était enfant), découvre John et sa mère Linda. Linda faisait partie de la civilisation et a été recueilli par les sauvages chez qui elle vit, malheureuse comme les pierres, depuis des années maintenant.
Bernard décide alors de les ramener vers la civilisation.
Ce roman est une dystopie assez glaçante il faut bien l’avouer. Écrit en 1931, juste après le krach de 1929, on se retrouve plongé dans un monde où le maximum de tâches est automatisé, où les gens ont peu de choix et où la consommation à outrance est portée aux nues tout comme l’ingestion de drogue. Et la notion de caste est poussée au maximum, car dès la création des embryons, leur destin est tracé. Des Alphas Plus qui sont grands, beaux, intelligents et uniques aux Delta et Epsilon qui sont petits et laids et produits en série de plusieurs dizaines d’individus identiques, tous sont poussés dans une case qu’ils ne pourront jamais quitter. Et leur conditionnement fait qu’ils sont heureux de leur sort.
Certains des slogans utilisés pour la mise en condition sont très percutants grâce à la nouvelle traduction de Josée Kamoun. Elle dépoussière le texte avec brio, et certaines de ses trouvailles sont à la fois drôles et brillantes comme « Un gramme à temps vous remonte pour longtemps » (l’ancienne traduction de Jules Castier étant : « un gramme à temps vous rend content »).
Trois préfaces (dont deux de Huxley lui-même) et une postface viennent enrichir ce livre et expliquer le texte qui reste — hélas — résolument moderne. La postface est rédigée par la traductrice, qui nous offre quelques explications sur le choix de ses mots, et il faut avouer qu’elle a fait un excellent travail. L’ensemble est très fluide à la lecture, les mots modifiés collent très bien à notre époque, et le tout reste très vivant et plausible.
Une nouvelle traduction qui nous offre une nouvelle lecture enrichissante de ce classique de la littérature dystopique que j’ai redécouvert avec plaisir.
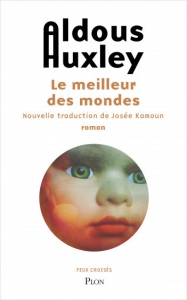
Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.