Dans cet essai abondamment documenté, comme en font foi les nombreuses notes de bas de page citant ses sources, Kate Brown raconte, en parallèle, l'histoire de Richland et Ozersk, les premières villes construites autour de la production de plutonium, respectivement aux Etats-Unis et en Union Soviétique.
Cette histoire commence, assez logiquement, pendant ou juste après la Seconde Guerre Mondiale : Les Etats-Unis ont besoin de plutonium pour le projet Manhattan, et la construction de l'usine de Hanford destinée à le produire nécessite des ouvriers. Leur embauche va être retardée par la vérification de leurs antécédents, ce qui semble logique dans un contexte de guerre, mais aussi par le racisme de l'époque. Ainsi y aura-t-il non une ville, mais deux, la seconde étant à la limite d'un bidonville, destiné aux afro-américains et aux immigrés mexicains.
Etant donné l'urgence de disposer de la bombe atomique, au moment de la construction la sécurité a souvent été sacrifiée au profit de la rapidité, d'autant que le lobby militaro-industriel aux commandes du projet ne semblait pas vraiment s'inquiéter des conséquences humaines et environnementales du travail avec des éléments radioactifs. Il est vrai qu'à ce moment-là on ne connaissait pas en détail l'action des rayons, et que les quelques recherches faites ont été soigneusement ignorées. Ce qui était important, c'était le secret. Ce qui est plus inquiétant et moins compréhensible, c'est qu'après la fin de la guerre, le secret et les impératifs de production de plutonium les plus hauts possibles aient été maintenus, sans tenir compte des risques de pollution du fleuve Columbia, par exemple.
Richland, construite pour les employés - blancs - de l'usine de Hanford, a représenté après la guerre le prototype même des banlieues américaines pour la famille nucléaire typique, avec les maisons avec jardin, la voiture, les appareils ménagers... Le rêve américain de la consommation, si l'on ignorait les barbelés et les check-points qui permettaient d'y accéder, et la surveillance omniprésente. Plus tard, ceux qui ont voulu enquêter sur le nombre de cancers, notamment, dont souffraient ses habitants ont été harcelés, et les affaires étouffées.
Alors que l'Union Soviétique, en la personne de Béria, avait été informée très tôt des détails de construction de la bombe atomique, il lui a curieusement fallu des années pour décider de s'équiper elle-même de l'arme nucléaire. Après la guerre, quand il est devenu clair que les USA considéraient le communisme, et donc l'URSS, comme un ennemi potentiel, ses dirigeants ont décidé de pourvoir à leur défense. Ainsi la construction d'une usine a-t-elle été lancée, dans une région peu peuplée de l'Oural. Mais le pays étant exsangue à ce moment-là et manquant de tout, les travaux, effectués à la main par des prisonniers, étaient très lents. Même après que Béria, furieux des retards, aura repris les choses en main, les maux endémiques de l'URSS (corruption, pauvreté, manque d'éducation de base...) occasionneront des délais et au moins un désastre, à Kychtym, en 1957, quand des containers de déchets radioactifs souterrains ont explosé.
Outre cela, des tonnes de déchets plus ou moins hautement radioactifs ont été déversés dans la Techa, une rivière peu profonde, au cours lent, paresseux et changeant, qui servait de source d'eau et de nourriture à plusieurs villages situés sur ses bords. Elle reste à ce jour la plus radioactive du monde, d'après l'autrice de l'essai. Les ordres d'évacuation de ces villages ont été peu suivis, pas suivis du tout, ou avec tant de retard que ça revenait au même. Cela a de ce fait permis aux médecins de suivre un grand nombre de personnes souffrant de contaminations radioactives sur un grand nombre d'années, dans le plus grand secret. En tout cas, il n'y a pas à s'étonner de la compétence des experts ouraliens envoyés à Tchernobyl après l'explosion de la centrale, car ils avaient une grande expérience de la façon dont les contaminations fonctionnaient, et de la manière dont on pouvait en minimiser les effets, autant que possible.
Il s'est écoulé une décennie depuis l'écriture de cet essai, et sa publication en anglais. L'autrice a fort utilement rédigé en préambule un prologue pour cette édition, que j'ai pour ma part trouvé désespérant, voire terrifiant. Elle y dit en effet que si rien n'a véritablement changé à Hanford, où aucune solution n'a été trouvée pour le traitement des déchets radioactifs, non plus bien sûr qu'à Mayak, l'usine russe, qui continue à stocker des déchets, sans sécurité suffisante pour éviter les contaminations environnementales, cet essai ne pourrait sans doute plus être écrit à présent. En effet, les documents américains qu'elle a utilisés sont redevenus inaccessibles, les témoins qu'elle a rencontrés disparaissent l'un après l'autre, et elle n'aurait pas pu obtenir un visa pour enquêter dans la Russie actuelle. Il n'en est que plus nécessaire de lire cet essai, avec ses témoignages bouleversants étayés par des articles de recherche.
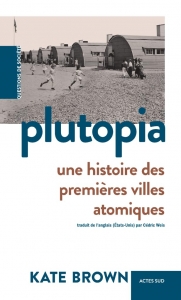
Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.