Prix Nobel de littérature 2022
Comment peut-on haïr de manière viscérale ses parents ? Telle est la question centrale autour de laquelle se déroule l’histoire du premier roman à caractère autobiographique d’Annie Ernaux, racontée ici dans sa version audio par Rebecca Marder.
La narratrice, Denise Lesure, dite Ninise pour les clients du café-épicerie parental, est en train de subir un avortement clandestin dans sa chambre d’étudiante.
L’attente des signes des contractions et le manque évident de préparation et d’informations pour faire face à cette situation l’emportent dans une kyrielle de souvenirs personnels. Des souvenirs faits de hauts et de bas, où chaque individu rencontré au cours de cette jeune trajectoire de vie (elle n’a que vingt ans) en prend plus ou moins pour son grade.
Pas évident à lire avec peu, voire pas, de respiration dans le récit. Les phrases s’enchaînent comme si les pensées étaient couchées sur papier au fur et à mesure qu’elles apparaissaient dans la réflexion de l’autrice. Pas de chapitrages, pas d’aérations, même les rares dialogues sont insérés dans le flot continu de l’histoire.
Une histoire qui navigue sans cesse d’un temps à l’autre, des souvenirs d’enfance dans un bistrot populaire aux bancs actuels de l’université où l’étudiante côtoie l’élite intellectuelle et bourgeoise. Les idées affluent, parfois sans aboutir, parfois pour y revenir plus tard. Un débit intense assez confus et déstabilisant mais qui fait aussi l’une des forces et des richesses de la plume singulière d’Annie Ernaux.
Derrière chaque mot, il y a un choix de décrire et d’analyser des évènements de la vie de manière crue et imagée. Parfois vulgaire, il faut le dire. Et parfois même un peu gratuitement. Mais ça fait partie d’un tout. Il faut prendre du recul pour ne pas percevoir uniquement la haine et le mépris qui débordent de cette centaine de pages.
Je n’ai pas l’audace de remettre en question l’intimité ou le sens de cette histoire. Elle peut paraitre violente, douloureuse et maladroite tant on perçoit un trop plein, une rancœur sociale à travers cette expérience personnelle et pourtant universelle (tout le monde vit ou subit la socialisation à travers le prisme de la famille, puis de l’école).
Il faut laborieusement arriver à dénouer les fils de cette matière première pour passer au-delà d’un règlement de compte ingrat et poisseux avec ses racines. C’est un travail de longue haleine, brassé à coups de mise à distance, d’analyses de ce qui nourrit les stigmates sociaux et l’habitus qui compose l’ensemble des comportements et des choix (Ernaux partage avec Bourdieu et l’auteur plus récent, Édouard Louis, une filiation littéraire marquée par cette même expérience du transfuge de classe) pour mieux comprendre cette fracture sociale. Autrement dit, comment on arrive là où on ne devrait pas être.
Si l’enfant qu’elle était et la femme qu’elle est devenue ont la capacité de pa(e)nser les plaies aujourd’hui, on peut avoir toutefois l’étrange sensation, presque lasse, que chacun de ses ouvrages renvoie à ce déracinement. Celui-ci ne fait pas exception. Il en est même la genèse.
Enfin, pour ne pas passer à côté de cette lecture au ton sec, dur et amer, je pense qu’il est nécessaire d’avoir une vision globale des œuvres de l’autrice, dont son fameux La place, dans la même veine. Elle est loin d’être le personnage hautain et froid que certains décrivent. Je conseille par ailleurs de lire et surtout de voir l’adaptation du puissant et brûlant Passion simple dont personnellement je ne me lasse pas.
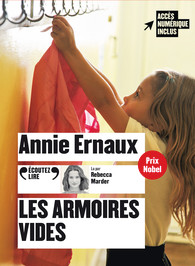
Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.