Tout le monde connait Marie-Antoinette d’Autriche, mariée à celui qui deviendra le futur Louis XVI. Elle arrive en France à quatorze ans et devient dauphine de France en 1770. Pendant longtemps, son mariage demeurera stérile, et ce n’est qu’au bout de huit ans qu’elle donnera naissance à sa première fille. D’abord aimée par les Français, ils se détourneront d’elle au fil des scandales, dont le plus retentissant reste l’affaire du collier. Ce qui est ironique dans cette affaire d’ailleurs, c’est le fait que Marie-Antoinette n’est absolument pas au courant de l’achat de ce collier en son nom par des escrocs. Mais c’est sur elle que retombe l’opprobre, d’autant plus qu’elle était déjà surnommée Mme Déficit pour ses dépenses jugée extravagante.
Il faut dire que Marie-Antoinette ne prend d’abord pas trop au sérieux son rôle de dauphine, puis de reine. Elle préfère jouer aux cartes, dîner au Petit Trianon ou aller à l’Opéra à Paris que d’être assidue à ses devoirs royaux. Elle préfère mener une vie simple au Petit Trianon plutôt que de côtoyer les fastes de la cour.
Mais la Révolution éclate et à la suite d’un procès bâclé — elle est accusée de haute trahison quasiment sans preuve —, elle va monter à l’échafaud.
Tout au long de cette biographie, on sent la tendresse que Stefan Zweig porte à celle qui fût la dernière reine de France de l’Ancien Régime. Il brosse le portrait d’une femme plongée dans une tourmente qu’elle ne comprend pas, barricadée qu’elle est entre les quelques châteaux royaux où elle gravite autour de Paris. En effet, la jeune femme ne visitera jamais le pays où elle vit depuis son mariage, se contentant d’aller du château de Versailles à Fontainebleau, à Marly, ou encore Saint Germain En Laye.
Même si cette biographie est légèrement romancée, elle s’appuie sur des recherches solides et écarte des événements rapportés dans d’autres biographie, comme la demande en mariage de Mozart quand ils étaient enfants, ou la scène finale où Marie-Antoinette aurait marché sur le pied du bourreau et se serait excusée. Zweig explique qu’il a passé beaucoup de temps à ne pas prendre en compte certains écrits, car beaucoup étaient des faux, Marie-Antoinette étant une piètre épistolière, pour se concentrer sur des écrits sûrs.
Il résulte de ce travail de fourmi une biographie très fournie, avec quelques détails intimes (comme l’opération du phimosis qui affectait le roi), un éclairage sur la relation de Marie-Antoinette avec ses courtisans et son mari, mais aussi avec Hans Axel de Fersen, un noble suédois qui était l’amour de sa vie et fera tout pour tenter de la sauver.
Comme d’habitude avec Zweig, c’est une excellente biographie qu’il nous livre ici, où Marie-Antoinette apparait comme une femme fière, mais aussi comme une épouse qui soutiendra son mari jusqu’au bout, et une mère digne qui réfutera toutes les accusations d’inceste dont on l’accusera au cours de son procès.
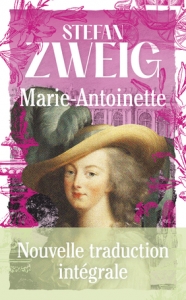
Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.