Faire le parallèle entre le nazisme et l’époque actuelle par le prisme du management, un pari osé mais pertinent et adroitement documenté par l’historien Johann Chapoutot dont j’avais très envie de découvrir l’écriture à force d’en entendre parler (surtout quand on a développé un attrait soudain pour la Seconde Guerre mondiale, la Résistance et les déportations).
Spécialiste contemporain des fascismes et de l’Allemagne nazie en particulier, Chapoutot a une approche historique, sociologique et culturelle des idées et des représentations nazies qui permet de comprendre ici l’origine d’une doctrine dévastatrice dont les ramifications s’étendent toujours à travers certaines organisations économiques et managériales modernes.
Une plongée d’emblée plutôt effrayante en termes de lecture que j’ai choisi de réaliser en trois temps par le biais de la version audio ici chroniquée, appuyée par sa version papier initialement parue en 2020 mais également par sa plus récente adaptation graphique parce que clairement ce n’était pas aussi facile et accessible que prévu même quand on affectionne cette période de l’Histoire.
Pour ne parler que de la version audio, le timbre de voix de Gabor Pinter est, j’imagine volontairement, froid et détaché mais cela donne une sensation désagréable avec une tonalité robotisée et un rythme trop lent et saccadé. Si l’on accélère le débit, le rendu est assez mal dosé parce que difficile à suivre d’autant plus avec les noms et les termes allemands qui, s’ils sont référencés à l’écrit, ne le sont pas à l’oral. Il m’aura fallu faire plusieurs recherches et aller-retour dans ma lecture afin de bien saisir les différentes étapes de construction du récit, certes court mais dense !
N'en demeure pas moins un essai historique qui se penche avec une effroyable lucidité sur la transformation politique de l’Allemagne nécessaire à l’avènement et la prospérité du Grand Reich caractérisé par la multiplicité des instances de pouvoir et de décision, en compétition permanente avec obligation de résultats mais sans responsabilités quant aux moyens laissés libres pour y parvenir (avec les folles conséquences humaines que l’on connaît).
Le contexte propice en Allemagne (défaite de 1914, quasi guerre-civile entre 1918 et 1923, hyperinflation, grande crise économique, chômage…) est un terreau fertile à la répudiation de l’État et au retour du communautarisme germanique dès les années 30. L’État-Providence est ainsi considéré comme inutile, voire néfaste et sclérosé, notamment dans son fonctionnement à travers des réglementations et des procédures tatillonnes et lentes là où les disciples nazis veulent pouvoir s’affranchir des inhibitions bureaucratiques pour libérer et accélérer les initiatives des forces vives, motivées et impliquées dans leurs missions.
Des forces vives à considérer comme étant celles régies par les lois de la nature (darwinisme social, racisme et eugénisme) que l’idéologie nazie prône par-dessus tout y compris dans le management et la gestion des ressources humaines en allant jusqu’à atteindre l’objectivation de l’être humain, « ravalé au statut de matériau ». Simple « facteur de production » qu’il convient d’exploiter ou de détruire par le travail et la production économique dans les camps de concentration par exemple.
On découvre que les nazis étaient ainsi des managers anti-étatistes convaincus, pour qui seul comptait l’objectif final de renforcement et de perpétuation de la race élue dans la logique et la dynamique de la nature. Une fois retournés à la conception communautaire, on ne gouverne plus, on manage (on dirige). Il n’est plus question d’avoir un prince souverain avec des sujets, mais seulement des compagnons de missions qui suivent un leader au nom de valeurs communes. Plus de luttes des classes (conception sémite marxiste) mais bel et bien une hiérarchie où l’individualisme ne trône plus.
C’est dans cette conception entrepreneuriale du IIIe Reich que se créent de nouvelles structures et réformes qui impacteront au fil des décennies suivantes l’élite économique et patronale de la République fédérale à travers des séminaires, des formations à distance, des manuels à succès pour apprendre à gérer les hommes. Plus exactement, apprendre à organiser de façon hiérarchique le travail en définissant des objectifs, où le producteur pour y parvenir demeure libre de choisir les moyens qu’il souhaite appliquer… du moment qu’il maintient l’illusion parmi la sphère salariale d’une certaine liberté ou autonomie d’initiatives et la joie de participer à une mission commune (à deux doigts d’avoir inventé le team building…).
Trouver du sens, être convaincu de la nécessité de la tâche et enthousiaste au travail. Aller vite et bien, tout en faisant mieux avec moins. Un discours idéologique aux allures aliénantes et cauchemardesques que l’on retrouve pourtant avec effroi dans notre rapport actuel au monde du travail et dans bien des sphères productives y compris à l’international.
Voilà un essai éclairant et nécessaire à l’heure actuelle, à lire plus qu’à écouter, mais avec parcimonie en alternant d’autres lectures ou en procédant au choix de chapitre ponctionné afin de ne pas ressortir totalement asphyxié, pessimiste et révolté.
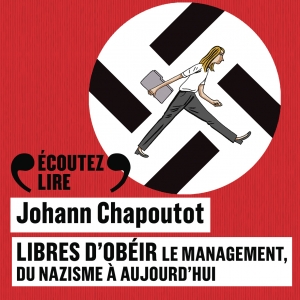
Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.