« Le onze février est devenu une date sans plus de valeur qu’une autre dans la longue succession des jours d’hiver. Pour moi, pour mes parents, en tête du cortège de l’indifférence. J’avais donné le ton, "rien de grave". Je l’ai répété autant qu’il le fallait. J’avais été désignée pour porter la honte. Pas eux. Ceux qui ont honte se cachent et se taisent. ».
Avec ses mots, Elsa Fottorino se réapproprie son identité (pas seulement son nom de « fille de »), son histoire et ses souvenirs des années après avoir enfoui au plus profond d’elle-même le traumatisme d’un viol dont elle a été victime dans une forêt d’hiver à l’âge de dix-neuf ans.
Verrouillée dans son silence, résignée par le classement sans suite de sa plainte (faute d'indices probants ou de piste tangible), acculée par la peur et la culpabilité d’avoir « laissé faire », de ne pas s’être enfuie quand elle en avait l’opportunité, de ne pas s’être assez battue, qu’aurait-elle pu éprouver de plus dans ce cas-là ?
Honte, colère, ressentiment ? En proie à un profond désarroi qui met finalement tous les autres sentiments en instance et diffère la peine en la retardant pendant des années, la narratrice se voit confrontée à son passé lorsque, douze ans plus tard, elle est reçue par la police judiciaire de Nanterre : un suspect a enfin été identifié et, cette fois, il y aura bien un procès.
Pour préparer l’audience, alors que depuis elle s’est efforcée de continuer à vivre et à aimer, qu’elle est devenue mère d’un petit garçon et attend la naissance de son deuxième enfant, elle doit se replonger dans l’indicible et affronter la parole ultime, celle qui raconte l’irracontable, factuel et précis.
Comme une remontée à la surface, après un long cheminement pour sortir des abysses obscures et froides, ce récit témoigne avec pudeur de l’enchevêtrement des pensées, de la confusion, des émotions bouleversées et bouleversantes. Tout comme aucune histoire de viol ou d’agression sexuelle n’est semblable, aucune victime ne ressemble aux autres.
Il aura fallu que le suspect continue de commettre ses crimes pour qu’après de longues années, l’une des victimes permette son arrestation et sa confrontation. De lui, la narratrice ne veut rien savoir, ni connaître, ni expliquer, ni réinjecter de l’humanité, du langage, de la pensée là où on ne peut voir que la cruauté d’un être donné à la vie pour la détruire.
Certains passages m’ont un peu perdue dans le voyage confus et nébuleux des souvenirs que l’on sent parfois encombrants pour la narratrice qui s’est coupée d’elle-même pendant trop longtemps.
D’autres moments sont en revanche absolument déchirants d’effroi telle la description des impressions, superposées les unes aux autres, laissées par le traumatisme de la scène avec cette sensation d’éloignement de la vie, du bruit étouffé des moteurs perdus au loin, du goût de la terre, du froid déposé sur son visage, du corps agenouillé et des chairs blanches meurtries… Ou à travers l’énumération des « et si » pour remonter le temps et éviter l’existence de la cause première, celle qui s’est élaborée, lentement et minutieusement, à son insu, permettant l’avènement du drame et la précipitant « du côté de la défaite » avec la peur née ce jour-là.
Parle tout bas est ainsi une histoire intime, certes pas facile d’accès par sa construction, mais il est difficile de juger la forme lorsque l’on connaît la complexité de ce genre d’exercice introspectif, que l’on espère salvateur et réparateur tant l’autrice semble avoir surtout mené un combat contre elle-même durant toutes ces années, et même encore lors du procès.
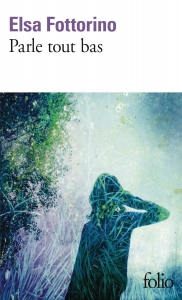
Cette page est une version simplifiée pour les robots. Pour profiter d'une version humaine plus conviviale, cliquez ici.